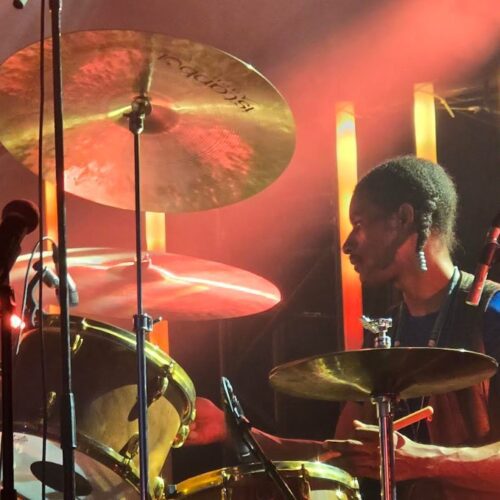Imaginées en temps réel à Cologne, le 24 janvier 1975, les impros incarnées du célébrissime Keith Jarret avaient marqué l’imaginaire sur la planète jazz. Un demi-siècle plus tard, The Köln Concert demeure sans contredit l’album piano solo le plus célèbre du genre. Sans surprise, je fais partie des millions de fans l’ayant écouté jusqu’à en faire traverser l’aiguille de ma platine dans le vinyle.
L’année de mes 18 ans, je ne connaissais pas alors les albums solo de Chick Corea (Piano Improvisations, 1971), Paul Bley (Open, to Love, 1972) ou Cecil Taylor (Indent, 1973) que je préfère désormais… et je sais fort bien que ces enregistrements n’ont pas eu le centième du rayonnement de The Köln Concert. Pourquoi donc?
Cet album est un mélange de folk post hippie, de musique romantique, de gospel, de soul et de jazz contemporain parfaitement consonant. La charpente de cette impro historique est relativement simple, ce qui se passe dans les impros (surtout de la main droite) peut être toutefois complexe et virtuose.
The Köln Concert fut un tremplin pour ce sous-genre que l’on qualifie de jazz de chambre, carrément la locomotive des centaines d’enregistrements produits par le légendaire Manfred Eicher sous sa fameuse étiquette ECM.
On peut certes comprendre cet impact universel et pourquoi l’altiste François Vallières en a adapté les 4 « mouvements » pour quatuor à cordes. Excellent coup de Marc Boucher à la barre du Festival Classica, présenté dans la superbe église Sainte-Famille de Boucherville.
Qu’a fait François Vallières ? Il en a d’abord retranscrit la main droite et la main gauche, pour ensuite procéder à des harmonisations à 4 voix (ou plus lorsque les cordes sont doublées à l’archet) et transformer la texture de cette œuvre sans la dénaturer.
Plutôt que de choisir un premier et un second violon, il a distribué les responsabilités de soliste à Marie Bégin et Antoine Bareil, ce dernier étant chargé de reproduire les élans les plus virtuoses de la main droite de Jarrett. Impressionnant de voir des musiciens classiques d’aujourd’hui capables d’intégrer un « feel » jazz à leur exécution.
Le travail le plus remarquable de François Vallières se trouve à mon sens dans l’organisation d’une interaction inspirée des cordes et dans l’attribution des rôles. Pendant que le violoncelliste Stéphane Tétreault campe ici un rôle proche de la contrebasse en assurant le rythme dans les basses fréquences, ses collègues exécutent un contrepoint qui dépasse la transcription d’un solo de piano. L’altiste Elvira Misbakhova occupe aussi un rôle important dans l’affaire, tant dans le jeu d’ensemble que dans certaines parties individuelles.
Le concert du 24 janvier 1975 devient ainsi un quatuor à cordes qui se tient et qui fera son chemin.