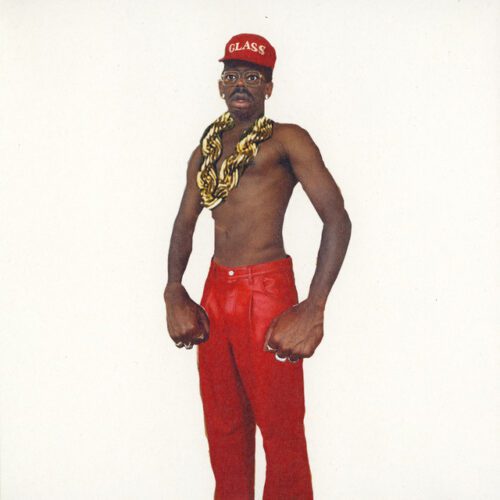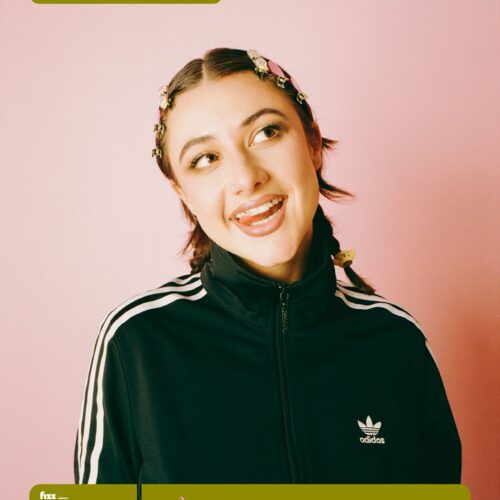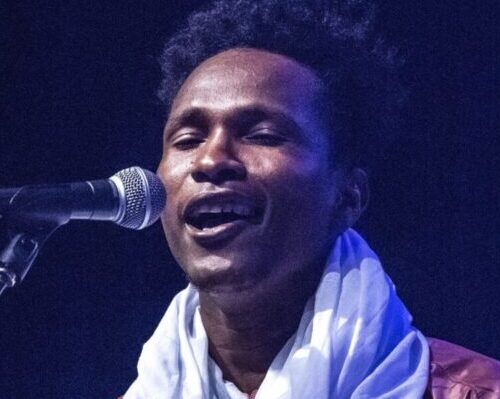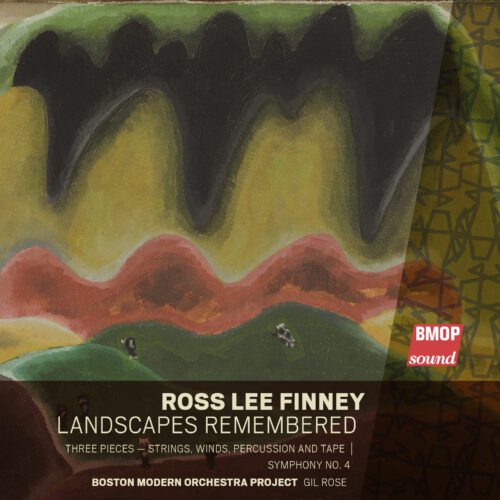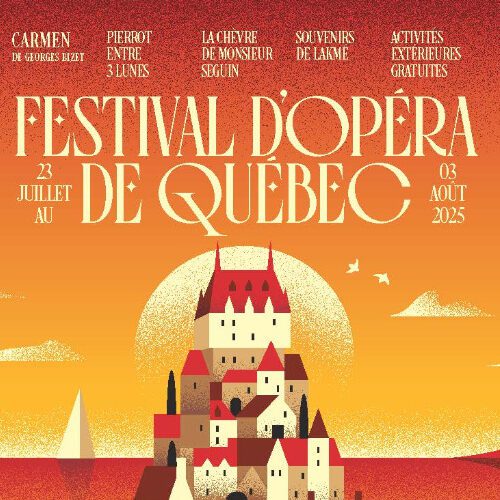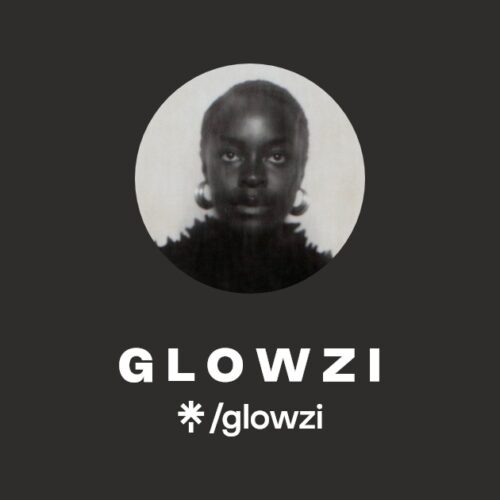L’événement Le quatuor selon Ali Zadeh, organisé par le Quatuor Molinari et se déroulant sur trois journées, atteignait son point culminant samedi soir, le 15 février, à la salle du Conservatoire de Montréal. En présence de la compositrice, petite femme élégante de 78 ans, on y a écouté, probablement pour la toute première fois au monde, la totalité de ses quatuors à cordes d’une seule traite. Une totalité d’autant plus inédite qu’elle comportait la création d’une œuvre écrite spécifiquement pour les Molinari, son quatuor Farewell.
ÉCOUTEZ L’ENTREVUE RÉALISÉE AVEC OLGA RANZENHOFER DU QUATUOR MOLINARI
Après une mise en bouche assez fournie et débitée à toute vitesse par l’artiste multidisciplinaire Nicolas Jobin, également ‘’spécialiste’’ de l’oeuvre de Franghiz Ali Zadeh, les sept quatuors de la compositrice azerbaïdjanaise ont été lancés dans un ordre non chronologique, contrairement à l’habitude du Quatuor Molinari dans ce genre d’événement. Une idée de Mme Ali Zadeh qui, je pense, s’est avérée heureuse car elle privilégiait une alternance entre les œuvres harmoniquement ‘’modernistes’’ et celles plus ouvertement ‘’folkloriques’’.
Je ne résumerai pas ici chaque pièce, mais l’impression finale des nombreux auditeurs présents est probablement celle d’une fusion authentique, savante sans cérébralisme abscons, d’univers musicaux orientaux et occidentaux. Le langage des chants sacrés azéris, appelés mughams, est omniprésent dans la palette expressive d’Ali Zadeh, mais avec des variantes d’intensité et d’explicité selon les quatuors. Si Reqs (Danse) de 2015, et surtout Mugham Sayagi de 1993, son œuvre la plus célèbre (créée par le Kronos), sont fortement teintés de ce que des oreilles occidentales perçoivent comme de l’orientalisme évident, d’autres comme Dilogia (1974, rév. 1988), In Search Of… (2005), et même la création Farewell (2025) s’inscrivent plus fortement dans un sillage hérité de la modernité chromatique, voire carrément de la Seconde École de Vienne (Farewell est explicitement inspiré du Concerto À la mémoire d’un ange d’Alban Berg). Cela dit, même dans ceux-ci, l’âme d’une musique savante liée au chant sacré islamique demeure perceptible, pour qui sait écouter.
C’est ainsi que l’on peut affirmer que la musique de Franghiz Ali Zadeh est une authentique fusion, un syncrétisme brillant, naturel d’autant plus que vécu personnellement par l’artiste tout au long de sa vie (la conférence de Nicolas Jobin fut, à cet effet, très éclairante). Cette musique est encore plus puissante dans son expressivité car Mme Ali Zadeh possède deux atouts majeurs supplémentaires : elle est d’abord une excellente narratrice musicale, qui sait raconter des histoires suffisamment focalisées pour planter un décor vivant, mais aussi laisser un espace interprétatif, autant pour les musiciens que pour les auditeurs, afin de permettre à chacun et chacune de s’y plonger avec une certaine liberté de perception. Deuxièmement, Ali Zadeh est une fine coloriste, qui utilise toute la palette, ou presque, des techniques cordistes telles le col legno battuto, les tremolos, les glissandos, les pizzicatos, les sourdines, etc. Ailleurs, les musiciens chantent, ou (dans Mugham Sayagi), jouent également des percussions, se déplacent sur scène et jouent en coulisses. Aussi, les rythmes utilisés par Mme Ali Zadeh, souvent exigeants mais propulsifs, finissent d’octroyer à sa musique une accessibilité contagieuse.
Pour cette facilité de réception, additionnée à un savoir académique élaboré et une complexité structurelle tout sauf obtuse, la proposition musicale de Franghiz Ali Zadeh est l’une des plus inspirantes de notre époque, peut-être l’une des plus porteuses d’avenir en création contemporaine.
Ce genre d’événement de stature mondiale (qui comprenait également deux journées précédentes de conférences et de discussions) est à marquer d’une pierre blanche car elle fera date. Le Quatuor Molinari nous a donné le genre de privilège que connaissent beaucoup mieux les mélomanes de Berlin, de Vienne ou de Paris. L’ensemble a pour cela bénéficié de l’appui d’un mécénat aussi clairvoyant qu’essentiel (la Fondation Famille Lupien, pour ne pas la nommer…), auquel nous sommes reconnaissant.
Je terminerai avec une flèche lancée à quelques ‘’concurrents’’ médiatiques (pardonnez-moi, mais vous comprendrez) : à ma connaissance, personne, ni de Radio-Canada, ni de La Presse, ni du Devoir, n’était présent. C’est dire le déplorable état culturel des grands médias traditionnels, incapables de saisir le caractère unique et historique de cet événement.