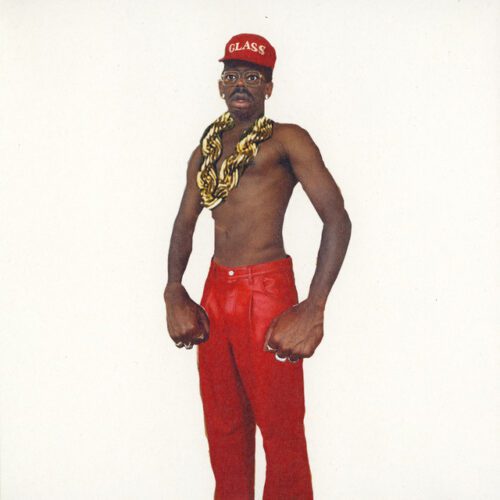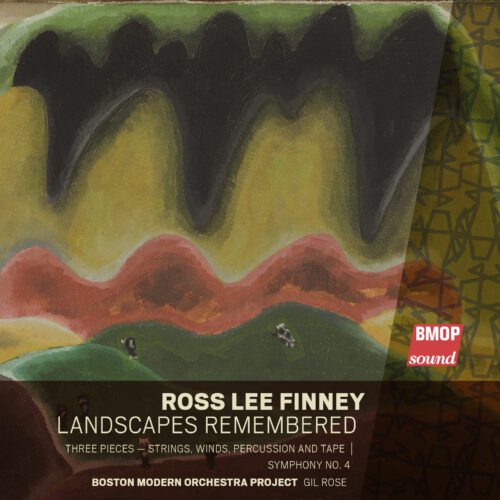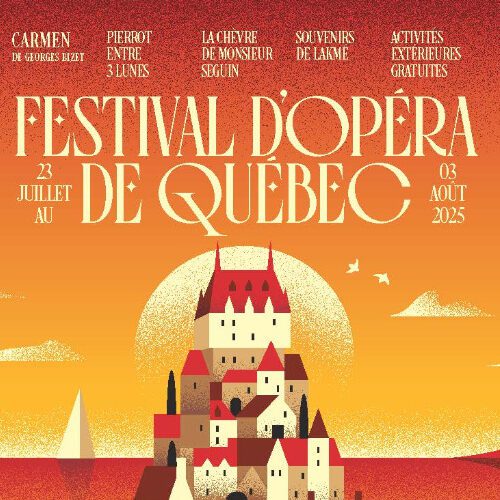C’est une salle comble qui, samedi soir, a accueilli la recréation du Concerto pour violon du norvégien Johan Halvorsen avec la jeune violoniste de 20 ans María Dueñas, et à la 7e symphonie de Dmitri Chostakovitch, dite Leningrad, le tout dirigé par Yannick Nézet-Séguin.
Dans le cas qui nous occupe, le terme recréation est à prendre avec des pincettes. Disons simplement que personne ici n’avait encore entendu de son vivant une exécution de l’œuvre. En effet, on a longtemps cru que la partition avait été détruite il y a plus de 100 ans. Cependant, la dédicataire du concerto, la violoniste canadienne Kathleen Parlow, a ramené au pays une copie de la partition et c’est en 2016 que l’œuvre a été retrouvée dans les archives de l’Université de Toronto. Selon les notes de programme, il n’y aurait eu que quatre exécutions du concerto depuis sa conception.
Nous assistions donc à la première nord-américaine.
Comparé au concerto de Bruch et à la musique de Grieg par Yannick Nézet-Séguin en allocution d’avant-concert, ce concerto a la forme inhabituelle d’une durée approximative de 26 minutes ne laisse aucun répit à la soliste. Et pour cause, ce sont deux cadences exigeantes qui ouvrent le premier mouvement avant que l’orchestre ne prenne la relève. Les deux premiers mouvements s’enchaînent sans interruption presque sans que l’on ne s’en rende compte. Le troisième mouvement est empreint de folklore avec ses rythmes fougueux. Il y a dans ce mouvement deux beaux passages dialogués entre soliste et orchestre, et même des récitatifs. Ce n’est pas un concerto qui est difficile à accompagner, mais on note une orchestration colorée et fine.
Dueñas traversera l’œuvre en multipliant les prouesses techniques tout en gardant un sens du lyrisme digne d’une maturité déjà acquise. Elle évite de tomber dans le piège du sensationnalisme et en donne juste assez pour que l’on ne décroche pas. En guise de rappel, l’orchestre et la violoniste ont joué une œuvre intitulée « La fille qui chante », probablement du même compositeur, qui nous a permis d’entendre une sensibilité touchante qui n’aurait pas eu sa place dans le concerto.
Mais quand est-ce que tout ça va s’arrêter ?
L’auteur de ses lignes était dans la salle en 2016 quand l’Orchestre symphonique de la Radio-Bavaroise et le regretté Mariss Jansons avait posé ses valises à la Maison Symphonique pour donner une véritable leçon de musique au public montréalais dans la 7e symphonie de Dmitri Chostakovitch. La performance avait été magistrale et plaçait la barre très haut pour le Métropolitain.
Composé en 1941 pendant le siège de plus de 900 jours de la ville de Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg par les nazis, Chostakovitch, lui-même enrôlé comme pompier volontaire dans l’armée russe, écrit cette symphonie, sa plus longue, de prime abord pour motiver les troupes face à l’ennemi. Mais on comprend vite le double sens caché antitotalitaire de son auteur.
Après une introduction majestueuse, le point de bascule de cette symphonie commence dès la cinquième minute. Sur un ostinato de caisse claire rappelant le Boléro, les cordes font entendre un thème archi-simple, qualifié même de « niaiseux » et « bébé » par le chef. Pendant plus de dix minutes, ce thème sera transformé tranquillement, insidieusement en une immense « machine de guerre », caractérisée par d’abondantes percussions et par une seconde section de cuivres complète ajoutée de l’autre côté de la pièce. Dès lors, on comprend vite à quoi on aura affaire pour les 60 minutes qui suivront.
Si l’orchestre a dépensé peu d’énergie avant l’entracte, c’est tout le contraire pour la suite. Jamais les musiciens et le chef ne relâcheront l’intensité requise pour rendre cette partition exigeante. Même dans les moments plus calmes, on sent toujours que le danger guette, qu’il faut rester sur ses gardes. À juste titre, le second mouvement est sombre malgré le rythme de danse qui le caractérise. Le thème principal du troisième mouvement est joué avec beaucoup de poids en plein archet par les cordes, ce qui empêche de tomber dans les pleurs et la désolation.
On se souvient de Jansons-BRF de 2016 et on se souviendra longtemps de Nézet-Séguin-OM de 2023. C’est une musique qui provient des tripes et qui nous pénètre jusqu’au plus profond de soi. Dieu seul sait d’où Yannick est allé puiser l’intensité donnée au dernier accord d’une finale qui ne veut pas finir, pour tout relâcher, comme une libération. C’est d’ailleurs ce qui a donné le sous-titre de cette section; pas parce que c’était mauvais, bien au contraire, mais parce que c’est ce que cette exécution représente : l’angoisse constante et la peur face à la barbarie.
crédit photo: Denis Germain