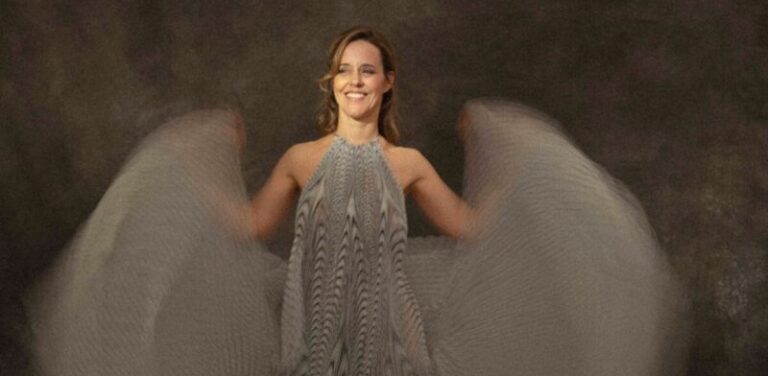Le naturel, et la nature en général, ont eu le dernier mot ce dimanche à l’Amphithéâtre de Lanaudière pour le concert de l’Orchestre métropolitain (OM) dirigé par Yannick Nézet-Séguin, avec l’impérial Marc-André Hamelin au piano. Rappelons que c’est la jeune sensation Yuja Wang qui devait être là, mais malade depuis quelques jours, elle a dû déclarer forfait. À Lanaudière, les miracles existent, selon le directeur artistique Renaud Loranger. Il n’a peut-être pas tort, car remplacer à pied levé une artiste aussi intense que Wang par un maître absolu de son art tel que Hamelin, c’est en effet une bénédiction.
Avec l’OM et Yannick, ce sont les deux concertos pour piano de Ravel qui étaient au menu, celui pour la main gauche et celui en sol, bien sûr. D’entrée de jeu, on a su que l’on n’avait rien perdu au change, car le pianiste québécois a saisi à bras le corps, sans jamais relâcher la pression un instant, ce Concerto pour la main gauche en ré majeur, si explosif dans ses contrastes, si nerveux et urgent dans ses motifs et ses mélodies, si éclaté dans ses références, passant du jazz à la musique militaire, le modernisme et le lyrisme. Hamelin a contrôlé tout le discours et le pacing de l’œuvre, avec une confiance inébranlable, à laquelle Yannick et l’OM se sont soumis avec grâce, abreuvant leur partie musicale de couleurs fébrilement tracées par le chef. Certains solos à l’orchestre n’étaient pas transcendants, loin s’en faut, mais bon… Heureusement, ce genre de musique est une seconde nature pour le pianiste québécois, comme s’il n’avait jamais besoin d’y réfléchir, juste de laisser aller son instinct et son Moi essentiel, ce qui a retenu toute l’attention du public.
Le Concerto en sol majeur, plus substantiel en contenu quoique pas beaucoup plus étendu en durée, est une merveille absolue, qui fait partie de nos psychés mélomanes collectives. Ici, si on a pu sentir une lenteur à ‘’entrer’’ dans le jeu, vite résorbée. Les deux mouvements externes ont témoigné d’une belle maîtrise du jeu textural à l’orchestre, par Yannick, et du discours pointilliste par Hamelin. Quelques rares envolées m’ont semblé moins limpides dans leur exécution que celles du concerto pour main gauche. C’est dans le mouvement central, qui est l’une des plus belles plages musicales de l’Histoire, que le pianiste a montré une adéquate poésie, et une douceur bienveillante. Pas supérieur à ce qui se fait de mieux, mais pas inférieur non plus. Bref, une lecture de haute qualité, de celles qu’on attend des meilleurs artistes du monde. L’OM a raté la marche vers le meilleur standard de cette œuvre, en particulier dans les solos de bois qui précèdent le grand et merveilleux soliloque du cor anglais. Des maladresses esthétiques ont été perceptibles dont une respiration inappropriée à la flûte et une attaque un brin vulgaire à la clarinette. Le solo de cor anglais lui-même, bien que joliment chanté par l’excellente Mélanie Harel, aurait pu être projeté avec plus de force et de présence altière face à l’orchestre. Bref, c’est dans ce genre de détails infinitésimaux que la différence entre l’OM et l’OSM se remarque. Une coche peut-être, mais qui fait la différence pour ceux et celles qui écoutent avec attention.
Hamelin a été salué presque héroïquement par le public, auquel il a offert de magnifiques Jeux d’eau du même Ravel. Autre miracle Lanaudois : c’est exactement au moment culminant de la pièce que le tonnerre et la pluie se sont mis à tomber, dans une symbiose spontanée aussi merveilleuse que rigolote. On aurait voulu le programmer que ça n’aurait jamais marché.
En entrée de programme, Yannick avait choisi une fort jolie partition impressionniste de Lili Boulanger, D’un matin de printemps, qui a mis la table assez correctement pour ce qui allait venir, soit un jaillissement continu de couleurs orchestrales.
Comme si la densité musicale n’avait pas encore été assez maximisée, le concert s’est terminé avec la substantielle Symphonie n° 2 en ré majeur, op. 43 de Sibelius. Cette fois, la nature n’a pas collaboré de façon bienveillante avec les musiciens. Après quelques minutes bien installés dans le premier mouvement, public et artistes ont dû faire une pause dans la communion musicale car le déluge, non seulement bruyant, s’est même imposé jusque sur la scène en raison d’une fuite du plafond, risquant du coup d’abimer les instruments des interprètes, surtout les cordes.
On a été déstabilisés par la reprise, qui ne s’est pas faite au début de l’œuvre comme annoncé, mais à peu près là où on était rendu. La stabilité retrouvée, on a porté attention au déploiement de ces pages sublimes entre toutes du répertoire symphonique. Yannick a réussit là où, je trouve, il n’a pas entièrement satisfait dans son enregistrement sous étiquette Atma. Dans ce dernier, une vision presque minérale, chtonique, alors que j’estime qu’il faut une approche aérée à cette symphonie, sans négliger l’ancrage au terroir. C’est un peu ce qu’on a eu alors que le ciel s’illuminait finalement. Le Finale a été adéquatement tenu et soutenu dans son ascension céleste et lumineuse si emblématique, si mystiquement puissante. Satisfaction, malgré les désaccords initiaux de Dame Nature.