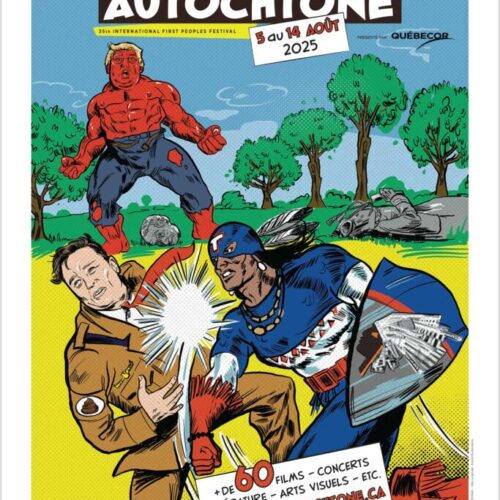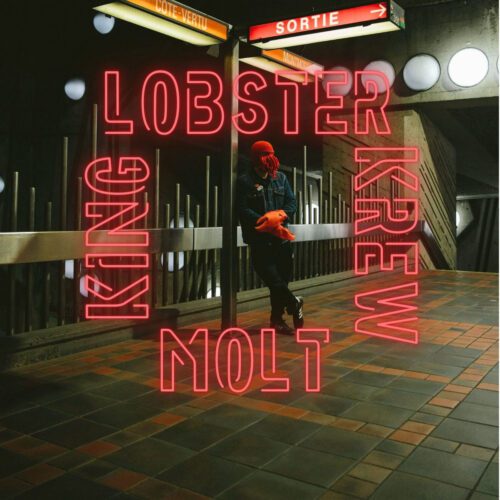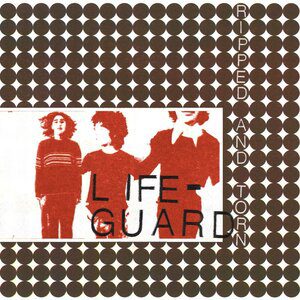Avec le temps, la musique de Pierre Boulez est devenue le maître-étalon du jugement que l’on peut porter pour OU contre la musique contemporaine. Un modèle de rigueur intellectuelle pour les uns, un épouvantail symbolique de cérébralité froide et rébarbative pour les autres. Peu importe la vision qu’on en a, on ne peut sous-estimer la portée et l’importance fondamentale qu’elle a eu et continue d’avoir sur le monde musical dans son ensemble.
Boulez a presque fait du ‘’work in progress’’ une marque personnelle. Plusieurs de ses grandes compositions ont été élaborées sur des années, même des décennies. C’est le cas du Livre pour quatuor, son seul et unique quatuor à cordes, qu’il a bien pris soin de nommer ainsi pour marquer toute la dissidence qu’il entendait incarner vis-à-vis la tradition structurelle en musique savante. Boulez a amorcé sa composition en 1948, et y travaillait encore à sa mort en 2016. Seulement cinq des six mouvements prévus à l’origine avaient pris vie, et ont même été enregistrés. Curieusement, mais c’est compréhensible dans le cas de Boulez, c’est le 4e et non le 6e mouvement qui manquait à l’appel.
Inachevé donc, mais suffisamment avancé et esquissé pour que le compositeur Philippe Manoury réussisse à le terminer et permettre, quelque 70 ans après la mort de Boulez, sa véritable naissance comme œuvre définitive.
C’est avec Livre pour quatuor que Boulez change de paradigme en tant que compositeur. Il venait de terminer les deux premières sonates pour piano, aboutissement de la première période, celle encore attachée à une certaine structure classique, lorsqu’il lança le chantier d’une nouvelle vie créative, axée sur le rejet des principes centenaires de la musique savante. Livre pour quatuor est un essai brillant et fondamental en sérialisme rigoureux, tant sur le plan ‘’harmonique’’ que rythmique. C’est l’un des premiers exemples les plus importants du ‘’son’’ de la musique contemporaine typique, celle que plusieurs ont appris à vénérer et beaucoup d’autres à haïr. Ce que j’appelle aussi le ‘’pointraitisme’’, car la musique est, dans une perspective d’illustration sonore bidimensionnelle, faites de points et de traits, des notes extrêmement brèves et d’autres soutenues plus longtemps (mais jamais pour devenir une ligne. Juste un trait).
Les changements de timbres sont brusques et incessants, les techniques utilisées très étendues (sul ponticello, col legno, pizzicato bien sûr) et les contrastes de caractères, subtils mais affirmés, s’enchaînent d’une sèche austérité à une souplesse presque improvisatoire (ce qui peut surprendre quand on connaît Boulez et son obsession maniaque pour le contrôle du discours).
Le dénuement de cette musique est total, et son interprétation est un accomplissement intellectuel, interprétatif et artistique remarquable. Les textures sont sans cesse étiolées, désagrégées, esquissées, pour ensuite tenter une nouvelle incarnation. On assiste à un ballet de particules quantiques qui s’animent de façon apparemment aléatoire, alors qu’en réalité la construction est nanométriquement calibrée et anticipée, mais à travers une science impossible à saisir pour le commun des mortels que nous sommes. Il ne reste qu’à y plonger en s’accrochant au sentiment de curiosité qui nous habite initialement, par rapport à ce qui se trouvera de l’autre côté.
Le Quatuor Diotima a déjà enregistré la version en cinq parties il y a plusieurs années, mais cette création ultime devient désormais le fin du fin en matière de boulézisme, ainsi que le geste qui clos définitivement le débat autour de cette oeuvre parmi les plus personnelles de Boulez (elle l’a accompagné toute sa vie!), et aussi les plus marquantes pour la musique du 20e siècle.