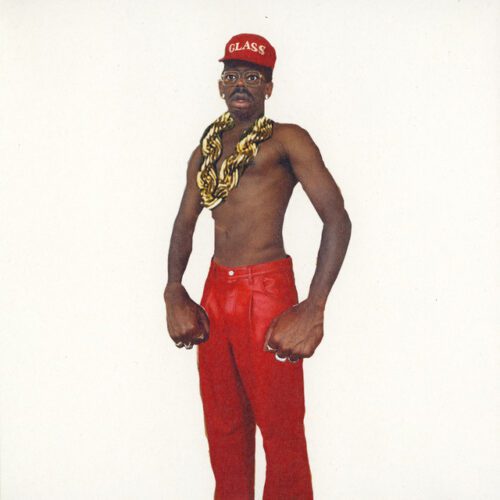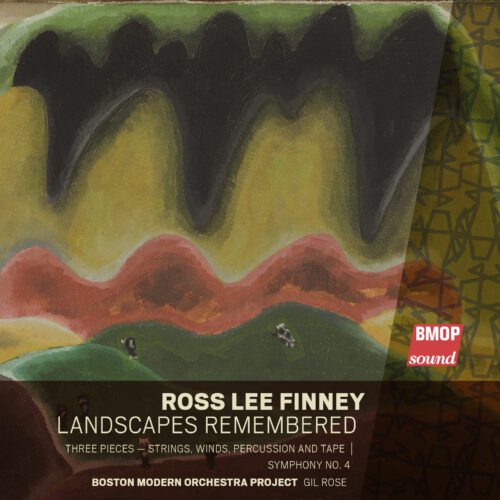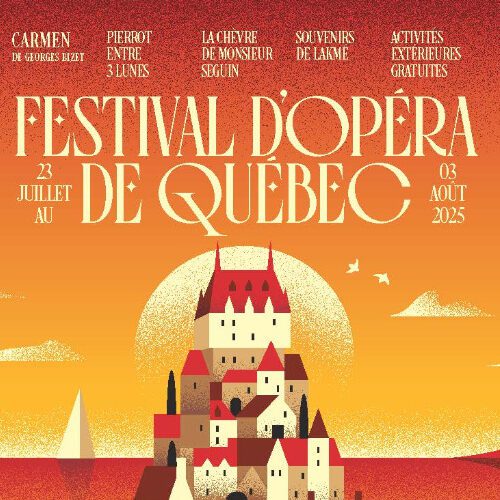L’un des meilleurs pianistes canadiens de sa génération, David Jalbert poursuit son intégrale des sonates pour piano de Prokofiev avec ce deuxième volume du corpus, qui se devra se terminer avec un troisième, inévitablement. Au programme, toujours chronologique : les 5e, 6e et 7e.
Comme dans le Vol. I, que j’avais apprécié lors de sa sortie (lisez ma critique ICI), je remarque les mêmes vertus de ce pianiste : superbe élégance des phrasés, maîtrise fine des dynamiques, allant du barbarisme au raffinement délicat avec aisance, et une grande habileté à équilibrer et clarifier les jeux très écartés des deux mains.
Jalbert réussit à donner une personnalité intéressante à l’étrange Sonate en do majeur op 38 (op 135 dans sa version révisée), no 5, qui passe du pastoralisme presque naïf à la modernité cynique en quelques minutes.
La Sonate no 6, en la majeur op 82, est la première des trois dites ‘’de guerre’’, écrite pendant le Second conflit mondial. Elle est un chef-d’oeuvre remarquable, une synthèse éloquente et spécifiquement prokofievienne d’un savoir académique passé au crible d’une féroce originalité.
Elle ramasse dans un espace musical de quelque 27 minutes un discours brillant qui invite la tonalité à frôler le précipice de ses possibilités politiquement contextuelles (Prokofiev était revenu en URSS depuis peu, et ressentait déjà le souffle de la censure stylistique stalinienne). Tout et son contraire s’y retrouvent imbriqués le plus habilement possible : la luminosité, parfois éclatante et la noirceur cynique, le lyrisme dansant et le motorisme rugueux, le raffinement et la vulgarité, la guerre et la paix. Jalbert est tout à fait éclatant de précision technique et d’émotions libérées. Le dialogue entre ses mains gauche et droite est d’une remarquable clarté, tout en équilibre malgré la puissance sonore exigée de l’ensemble.
Finalement, la Sonate no 7, en si bémol majeur op 83, la deuxième des sonates de guerre, poursuit dans la même veine avec un mouvement initial empreint d’inquiétude et de nervosité intermittente, comme maniaco-dépressive. Plus loin, l’atmosphère se transforme pour devenir plaintive, mais enchâssée dans un andante caloroso (chaleureux, amical) qui laisse perplexe. Encore une fois, aucune logique ne semble plus tenir, devant la folie extrême qui se répand dans le monde (1942 : les hordes nazies déferlent sur l’URSS, le Japon attaque Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre), ce mouvement tout en douceur cache en fait l’expression d’une intuition terrible : la race humaine marche, hypnotisée, vers l’abîme. Prokofiev, au-dessus de ce décor digne d’une apocalypse dessinée par Hieronymus Bosch, semble, comme le peintre, y apporter une touche désespérée d’humour sardonique.
Le dernier mouvement libère une sauvagerie tourbillonnante et essoufflante que Jalbert ne laisse jamais déraper. Dans les notes de livret, Georges Nicholson qualifie cette finale de Guernica en si bémol majeur. Que pourrais-je ajouter de plus pertinent?
Une seule chose, peut-être : Jalbert marche dignement dans les pas (les doigts!) de Sviatoslav Richter, créateur de l’œuvre en 1943, avec une lecture percutante et mémorable.
Le troisième volume, avec les Sonates nos 8 et 9, est très attendu!