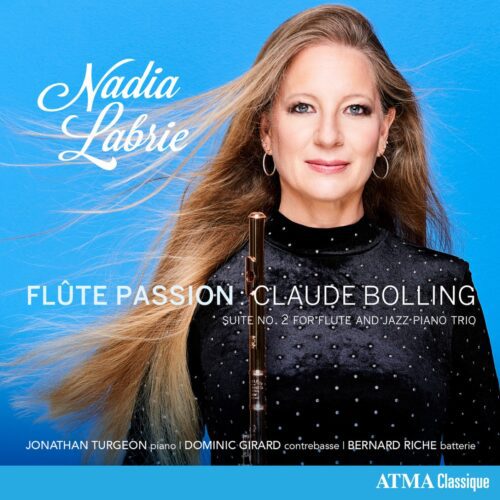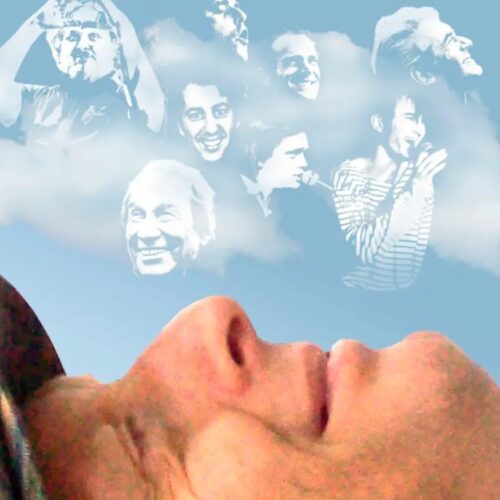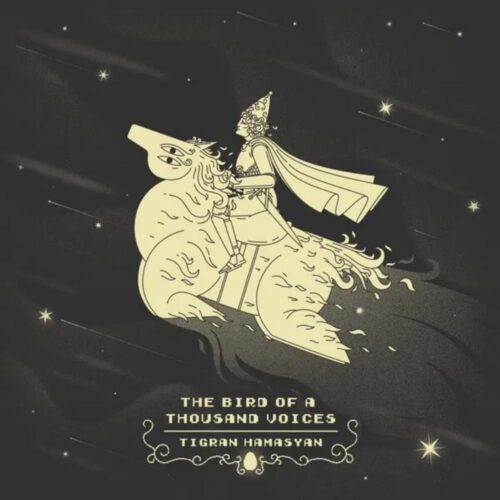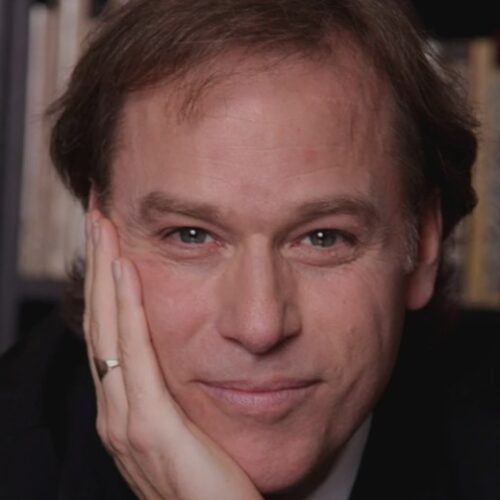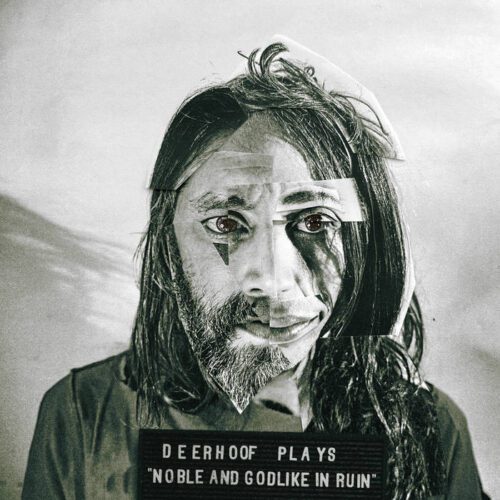Depuis les années 40, c’est à dire plus ou moins 8 décennies, le langage acousmatique se développe dans les institutions d’enseignement de la musique. Les jeunes concepteurs du programme de composition numérique y apprennent ce langage qui remonte à ladite musique concrète, et nous voilà en 2025 à écouter des étudiants qui tentent de s’approprier le langage en y insufflant leur propre bagage.
Ainsi, la Faculté de musique de l’UdeM présentait jeudi et vendredi derniers à la salle Claude-Champagne une cohorte de créateurs.trices à l’aube de leur contribution artistique chez les pros.
De Guillaume Myre, Aurélie Tessier et Samuel Gendron, le premier élément au programme de l’événement Ultrasons s’intitule Morphose, une œuvre mixte avec projections en direct, impliquant électronique, saxophone et guitare électrique, dont le jeu textural est la seule composante de l’expression dans le cas qui nous occupe. Construction intéressante qui s’amorce en douceur céleste et qui traverse quelques tempêtes avant de se calmer de nouveau.
Louis-Thomas Pineault, pour sa part, a choisi Entomorphérences, dont l’objet est d’explorer la zone tampon entre perception et imagination, et ce à partir d’enregistrements d’insectes autour desquels le compositeur a imaginé des sons complémentaires. Excursion entomologique au cœur de l’insectarium, en quelque sorte, avec des sons transformés (et méconnaissables) d’insectes et des emballages tout aussi transformés.
Matisse Charbonneau enchaîne avec une œuvre inspirée de la guerre en Ukraine. On en reconnaît les sons belliqueux, même si filtrés, traités, transformés. Les sirènes, les bruits de ferraille, salves d’on ne sait quoi qui tombent sur la tête des pauvres gens, entrechoquements, cris et hurlements, communications radio, le tout modifié à travers le prisme électroacoustique.
Antipodes, de Mateo Bellefleur Martinez, est un exercice esthétique dont l’objet est le lien qui se tisse entre les contraires, entre les postures les plus éloignées. Vrombissements, déflagrations, collisions.
Après l’entracte, Nicolas Bourgeois et Chloé Rivest présentent Lèvres, qui invite à« inspirer et expirer les signaux invisibles qui communiquent une intention ». L’esthétique très léchée impliquant danse et projections en temps réel, impliquent un travail sonore méticuleux, ambient énigmatique.
Le sol craque, le vent souffle au loin, Cendres Rivière a entrepris d’évoquer les sons de la nature nordique et les activités humaines qui s’y déroulent dans nos régions septentrionales. Voilà donc Eskers, une douzaine de minutes passées loin de la ville.
« Exploration d’un microcosme organique et foisonnant », Petrichor est un lent et sensuel pétrissage de sons linéaires, entrecoupés de sons percussifs ou même de gazouillis et autres grincements harmoniques. Cette belle courbe d’intensité est une gracieuseté de de Mahault Sampy.
Mikael Molliex conclut la soirée de jeudi avec Les outils de toute création, qui s’amorce par un drone caverneux assorti de crépitements et autres sons linéaire, marqués plus tard par des effets dramatiques et citations apparemment scientifiques, n’excluant pas des notes inscrites dans le système tonal. L’objet de cette œuvre, en fait, se veut la rencontre, ou l’évocation sonore de la rencontre avec les particules électriques, « outils d’une puissance créatrice et intelligente ».
On aurait pu aller en fumer du bon pour faire durer le plaisir mais il fallait se préserver pour la suite des choses. Soit un programme aussi chargé le lendemain, même lieu même poste.