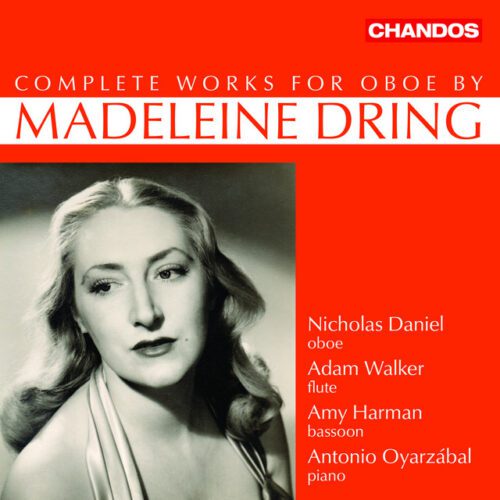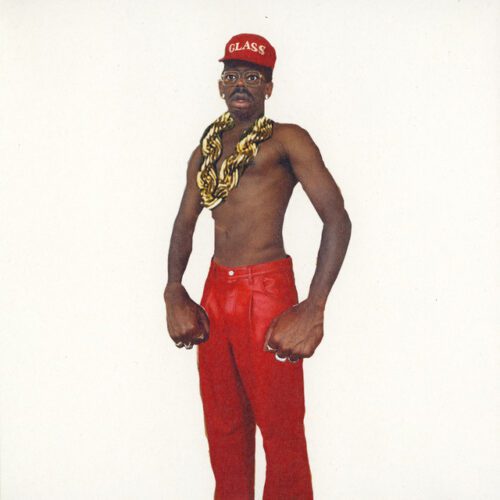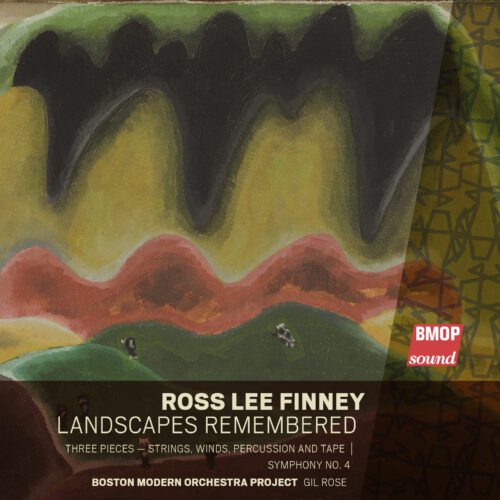L’un a dessiné minutieusement tous les plans d’un édifice majestueux, l’autre avait la responsabilité de le faire lever de terre, sur des fondations solides, en le parant des plus beaux atours et en l’élevant jusqu’au ciel. L’entreprise a admirablement réussi et le résultat dévoilé hier soir à l’Amphithéâtre de Lanaudière avait quelque chose d’olympien.
Je parle ici de la Symphonie n° 8 en do mineur d’Anton Bruckner, que les clichés explicatifs comparent toujours à une grande et magnifique cathédrale. Pour une fois, accordons aux clichés la part de vérité symbolique qu’ils véhiculent. L’avant-dernière symphonie du compositeur autrichien est effectivement grandiose et monumentale, qui plus est écrite dans un esprit de dévotion vibrante (Bruckner était très croyant). Cette œuvre de presque une heure et demie, réclamant un orchestre énorme, a donc tout pour stimuler une allégorie architecturale aussi impressionnante que celle d’une cathédrale. Notre-Dame? Reims? Strasbourg? Cologne? Peu importe, vous avez compris l’idée.
Payare a donc savamment construit hier cet édifice herculéen, avec des détails et des contrastes de dynamiques renforçant le drame spirituel à l’œuvre. Drame, oui. Car même si l’on compare la Huitième à une cathédrale, même si on dit, à juste titre, qu’elle est comme une immense prière du compositeur, qui nous invite tous et toutes à partager sa dévotion avec lui, la puissance des émotions recelées dans cette partition raconte une histoire personnelle de recherche de la transcendance.
Tout était parfait. Payare a contrôlé les élans dynamiques, sans vraiment les retenir, juste en communiquant, de toute évidence, la volonté de Bruckner. Comme un passeur spirituel. Les moments de douceur extrême étaient si peu audibles que les oiseaux à proximité résonnaient plus fortement. Le compositeur aurait été aux anges! Au contraire, les moments de magnificence emplissaient la cuvette naturelle du site comme le divin qui y prendrait toute la place.
Et quel orchestre! Payare et nous, sommes choyés. Intonation idéale des solos, des ensembles de sections et des tutti, phrasés de l’adagio sans précipitation mais avec une énergie inhérente palpable. Cet adagio d’ailleurs, et surtout cette ascension frémissante de cordes accompagnées des trois (!) harpes, célébrissime moment (qui revient plusieurs fois) qui transporte les mélomanes tout près des portes du Paradis, avait quelque chose de purement céleste, et parfaitement réussi. La finale du Finale, quant à elle, majestueuse construction, ultime finition d’un bâtiment sublime, qui abriterait n’importe quelle divinité suprême de n’importe quel culte (Dieu, Allah, Brahma, Odin, Râ, Zeus, etc., etc.), cette finale qui vous prend aux tripes et vous élève malgré vous, était grandiose à souhait, mais sans aucune vulgarité. Que du vrai, que du ressenti, avec respect et élégance.
Oh, je pourrais chipoter sur des détails. Les trompettes du Scherzo auraient pu être beaucoup plus incisives. Je les aime ainsi, voyez-vous. Pour marquer le côté plébéien du mouvement, a contrario de la piété du précédent. Et puis, ce dernier, dont les dernières mesures invitent au recueillement, aurait pu être, justement, un brin plus ‘’recueilli’’.
N’empêche, ce degré de qualité musicale est à porter au crédit de notre orchestre, assurément l’un des meilleurs au monde. Bravo aux solistes, impeccables, et en particulier Catherine Turner au cor. Quel travail exceptionnel, quelle justesse de ton, de sonorité, de couleur. La dame a été remarquable, maîtrisant un instrument si capricieux, et si souvent tenté par la trahison de celui ou celle qui le tient.
Le seul véritable bémol est à mettre au compte du public : le parterre n’était que partiellement comblé. Une honte, compte tenu de la qualité du moment qui était proposé.