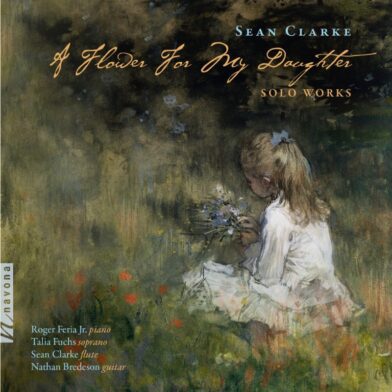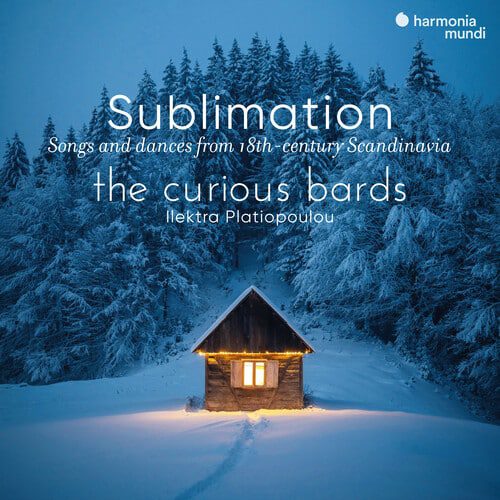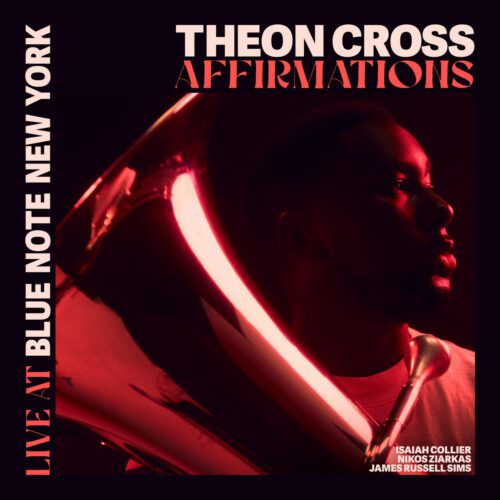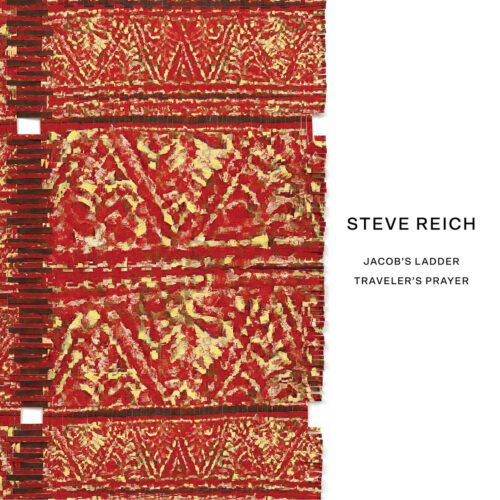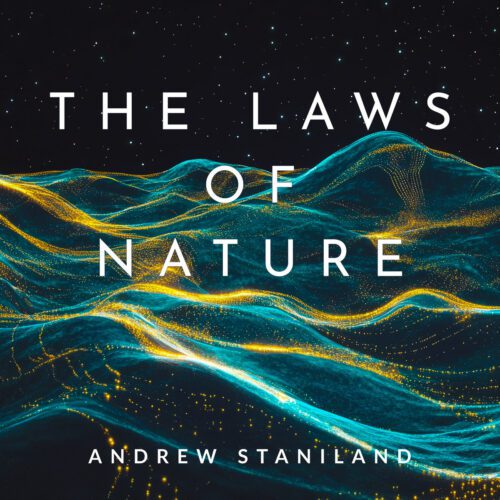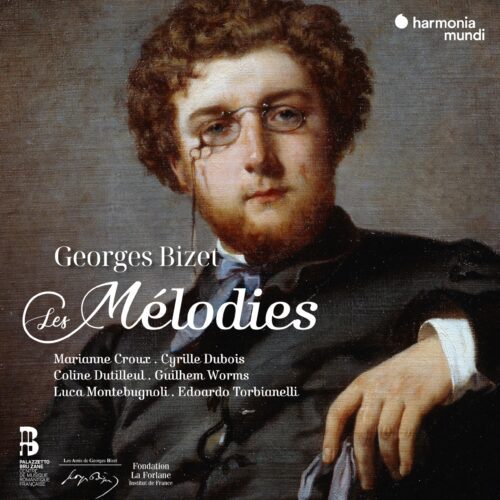La tourmaline est une pierre semi-précieuse aux reflets irisés qui semble constamment se jouer des rayons lumineux afin de les remodeler en une multitude de couleurs vibrantes. Un éclectisme naturel qui sied parfaitement à cet album éponyme de nouvelles compositions électroacoustiques pour saxophone et trame numérique.
Si les deux premières pièces de Tourmaline nous offrent un monde sonore agréable, ludique par moment, les deux suivantes nous transportent dans une dimension bien plus inquiétante, alors que la dernière se fait résolument contemplative. Le point commun entre toutes est l’approche symbiotique entre le saxo (qu’il soit soprano, alto ou ténor) et la trame électronique des compositeurs et compositrices. On est forcé de tendre l’oreille et de se concentrer pour tenter de séparer l’un et l’autre. Mais finalement, on abandonne pour se laisser empoigner par ces maelstroms sonores étranges et envoûtants.
Tourmaline d’Alexandra Gardner et Naica de Viet Cuong évoquent adéquatement l’opalescence lumineuse d’une minéralité ensorcelante. On assiste à un déploiement fascinant d’activité papillonnante, comme autant de particules élémentaires jouant à cache-cache dans un champ quantique en constant, mais léger, frémissement d’énergie.
C’est aussi beau et intellectuellement stimulant que c’est ludique et, malgré tout, accessible.

Angelus Novus de Seth Andrew Davis nous amène ailleurs, totalement. Inspiré d’un tableau de Klee, cette diatribe intense vire au white noise, comme un récepteur télé d’antan qu’on tente d’ajuster avec une antenne qu’il suffisait d’effleurer pour vous faire passer des Arpents Verts à une agression sonore extra-terrestre. Une expérience de schizophrénie auditive qui vire au psychédélisme extrême.
Seven Steps de Kenneth Michael Florence débute avec un continuo de riff guitaristique, suivi par le saxophone qui papillonne sur des effets de couleurs pianistiques, dans un paysage quasi pastoral. Les deux moods vont et viennent, puis s’imbriquent dans un dialogue de sourds qui finit par trouver son équilibre vers la fin, bien que de façon précaire, et surtout indécise car le tout se termine… sur un bon vieux fade out!
Avec Sum of its Parts, Emma O’Halloran peint un paysage bruissant qui se révèle graduellement à nous et sert de soutien à un saxophone lyrique qui dessine des phrases amples et solennelles. L’ensemble donne l’impression d’un lever de soleil numérique sur une planète azimovienne. De l’impressionnisme 2.0 tout à fait réussi! La scène se complique vers la fin, avec l’arrivée d’un orage ou l’avancée d’un nuage de frelons (c’est selon). Étonnante et logique conclusion pour un album qui n’a cessé de nous surprendre et de nous séduire depuis le début.
Dylan Ward est un saxophoniste de grand talent qui ose être exigeant avec les mélomanes, mais en les récompensant d’une musique au discours clair et cohérent et aux sonorités originales doublées d’une franchise émotionnelle qui communique directement ses intentions. Contemporain, avant-gardiste, mais pas abscons pour deux sous.