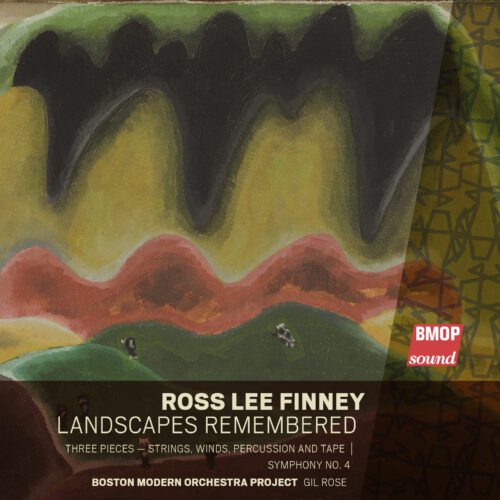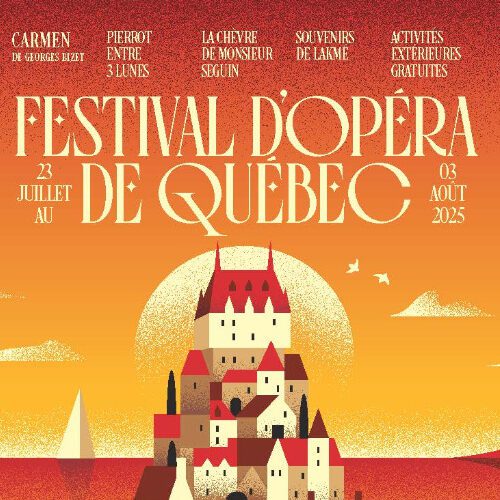Après avoir accueilli l’Orchestre de Paris et son jeune chef Klaus Mäkela en mars dernier et l’Orchestre de Philadelphie avec Yannick Nézet-Séguin un mois plus tard, c’était maintenant au tour de l’orchestre de la Ville Reine d’être accueilli dimanche dernier à la Maison symphonique de Montréal. Le Toronto Symphony Orchestra et son chef Gustavo Gimeno étaient de passage dans la métropole pour y présenter avec la mezzo-soprano italo-canadienne Emily D’Angelo, la suite enargeia, issu de son premier album du même nom paru chez Deutsche Grammophon.
Nous avions nous-mêmes recensé avec une grande appréciation ce disque lors de sa parution en octobre 2021, relevant « l’audace de la jeune chanteuse qui déjouait toutes conventions, au moyen d’un programme éclectique mélangeant œuvres médiévales enrobées d’indie rock électro et pièces de compositrices du XXIe siècle. »
La transposition sur scène avec un plus large effectif orchestral a-t-elle été réussi à rendre justice à l’enregistrement? Dans l’ensemble, nous pouvons dire que oui.
Dans cette version concert, D’Angelo ne retient que certains des éléments musicaux de son opus, conservant dans cette suite ceux qui nourrissent une trame narrative abordant la thématique de la mort et du repos. Après une ouverture résumant l’esthétique de l’œuvre par Jarkko Riihimäki qui signe également les arrangements des dix pièces de la Suite, Emily D’Angelo enchaîne les œuvres d’Hildegard von Bingen, Hildur Guðnadóttir, Missy Mazzoli et Sarah Kirkland Snider, oscillant entre une atmosphère planante et des moments de grande vitalité.
Après une introduction méditative de l’antiphonaire O Frondens Virga soutenu par une pédale de cordes qui se prolonge sur Fólk fær andlit de Guðnadóttir, c’est une complainte animée et angoissante (The World Within Me Is Too Small) qui amène la thématique de la mort de front. Moment phare du cycle, la transition entre la pièce Dead Friends et Lotus Eaters de Snider fait interagir avec ces contours pop une ligne vocale d’une grande profondeur avec un habillage de cordes auquel s’ajoute un ensemble de percussions avec batterie.
Sans perdre de son intensité, le retrait de l’arrangement de guitare électrique présente sur le disque, vraisemblablement pour des raisons d’équilibre et de balance sonore, changeait le lustre de la pièce et la particularité notable de cette pièce qui nous avait profondément saisi la première fois. Compréhensible, même si nous aurions aimé avoir droit à cette même audace.
Droite et vêtue d’un costume monochrome, D’Angelo a offert une performance sentie, remplie d’intensité et de nuances, tant sur scène que vocalement, même si nous avions l’impression qu’en début de prestation, la voix semblait quelque peu éteinte. Une impression qui s’est estompée au fil de sa performance où sa voix chaude, grave et envoûtante s’est fait entendre.
L’œuvre était encadrée de l’Ouverture Coriolan de Beethoven – interprété avec fougue et relief -, et la Symphonie no1 en do mineur de Brahms, autre pièce maîtresse de la soirée. C’est ici que le son et la direction mené par Gustavo Gimeno se révèlent. Gimeno – dans la même veine que Payare -, n’indique pas uniquement que des tempis, il dirige des phrases, des intentions musicales et des dynamiques. Cela confère à l’orchestre une amplitude d’une grande homogénéité et une sonorité claire et enveloppante.
Du premier mouvement avec son thème au caractère dramatique et sombre au complexe et majestueux finale aux influences beethovénienne éclatante, Gimeno construit le matériel musical avec une direction passive mais signifiante, c’est-à-dire en donnant juste ce qu’il faut à l’orchestre comme indication pour évoluer dans leur jeux instrumentaux, porter à différents moments les solistes Jonathan Crow (premier violon), Joseph Johnson (violoncelle) et Eric Abramovitz (clarinette), développer les thèmes, les lignes et les nuances dans ce qui aura été une performance classique, satisfaisante dans un concert riche en couleurs et en affects.
Crédit photo: Allan Cabral