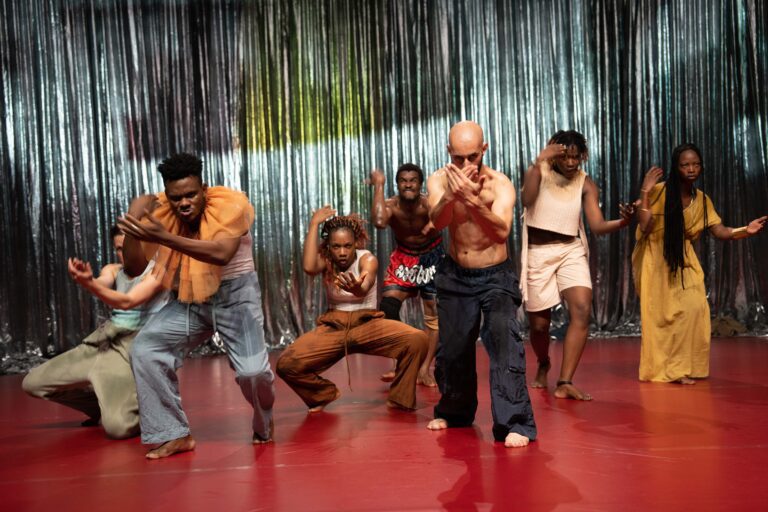Sorti en 2004, Planter le décor est un album-clé de Fred Fortin. Vendredi soir au Club Soda,son concepteur confiait à ses fans avoir résisté aux pressions d’en exécuter la matière sur scène. Il a fini par accepter lorsque sa tendre moitié a tranché : « Tu le fais ». Ce que femme veut, Fred le veut, et voilà une salle remplie à ras bord deux soirs d’affilée aux Francos de MTL, devant une foule essentiellement trentenaire et quadragénaire, venue revivre sa jeunesse pendant une paire d’heures.
Nostalgie quand tu nous tiens? Très rarement en ce qui me concerne, mais cela me semblait justifié cette fois. Justifié parce que Fred avait réuni l’alignement originel de l’album : Jocelyn Tellier et Olivier Langevin aux guitares, Dan Thouin aux claviers, Alain Bergé à la batterie, le chanteur aux basse et guitares, assurément un personnel de très haut niveau dans le paysage keb francophone.
Ce fut un show à la mesure de ces musiciens et leur employeur de Saint-Prime, soit un mélange très relevé de culture populaire et de recherche stylistique, mariage réussi entre virtuosité, pesanteur et rugosité bien placées, entre langue familière et langue plus fine.
De quoi être assurément ravi, deux décennies de maturité ont fait le travail: la saturation dans les fréquences basses et moyennes, les subtilités harmoniques et rythmiques en complément des accords rock, country ou blues, la haute virtuosité de ces interprètes, voilà autant d’éléments pour nous ramener dans ce décor planté deux décennies plus tôt.
Comme dans l’album, il a commencé par Mélane, le récit d’un homme à la dérive sous un ciel de vautours, s’adressant à sa compagne qu’il imagine telle une bouée de sauvetage pour son existence perturbée.
Il enchaînait par Conconne, l’assassinat rocambolesque d’une chanteuse idiote, balancée dans le fond d’un canyon par un mâle enragé. Le tempo s’accélère avec Lucia, lourd stoner rock mâtiné de prog et de country, servi à trois guits dans ta face.S’ensuit Pop Citron, pur country clopin-clopant, décrivant un loser pas vraiment beautiful, frimeur de roman savon dont la gueule se vend comme du pudding.
Il est alors le temps de faire plaisir aux collègues en déployant Ti-chien, une instrumentale polyrythmique aux accents de jazz et de prog, s’y démarquent les jazzmen du quintette – Tellier, Thouin et Bergé.
Tant qu’à être canin, voici l’histoire du chien Robeur qui s’ennuie et qui déguerpit jusqu’au rang 6 avant d’être repéré par son maître, autre stoner rock au tempo lent, assorti de merveilleux ponts.
Nous voilà à Chateaubriand, le filet mignon fantasmé par la traversée du désert sur fond d’un folk americana haché tartare par des beats de plus en plus costauds dont Alain Bergé a le secret.
Et re-country au petit trot, évocation d’une Dérape se concluant par un bon café qui chasse les mauvais esprits.
Un peu plus tard, le récit d’une autre dérape s’avère moins hop-la-vie, elle immerge la face du narrateur dans un bassin de Scotch , triste brosse d’un mec sans compagne, ça file un mauvais coton. Le narrateur doit rentrer en taxi, l’harmonica plaintif se fond dans le prog-rock archi-saturé, nous sommes touchés par le dialogue entre les guitares et la basse, soutenus par des claviers impressionnistes et un beat on ne peu plus viril.
Une fois l’album entièrement joué, le quintette de Fred Fortin enchaîne une autre dizaine de ses classiques au grand plaisir de ses fans de la première ligne, complétant le tout par trois rappels, deux acoustiques et une dernière pour la route avec formation complète, la Loi du chocolat.