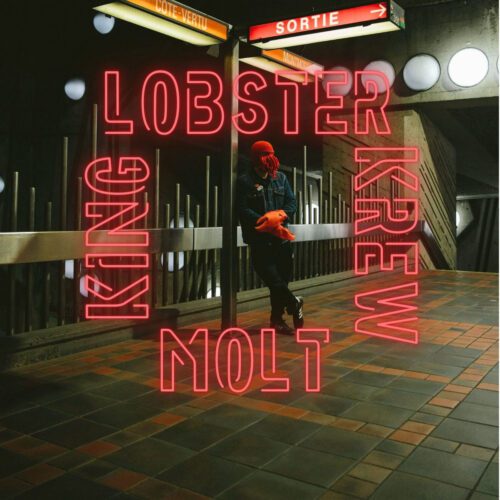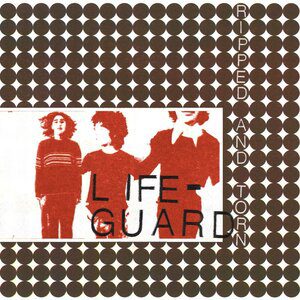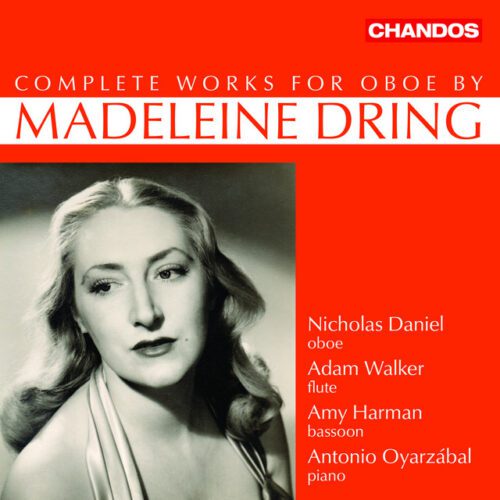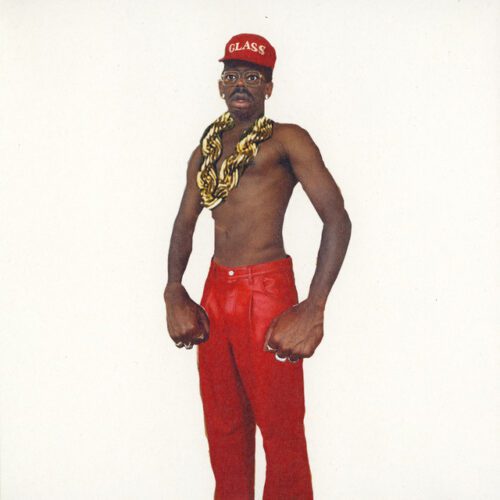Il y a 40 ans, le jazz avait perdu considérablement de sa valeur marchande, le rock et la contre-culture en avaient diminué la coolitude. Les seuls musiciens associés à cette forme qui attiraient des foules substantielles étaient les artistes liant le jazz au funk et au rock, c’est-à-dire des formes liées à la jeunesse de l’époque. On pense à Chick Corea, Mahavishnu Orchestra, Weather Report, etc.
Et puis le CD est devenu le support dominant dans les années 80, les étiquettes de disques pouvaient alors remettre aux goûts du jour les répertoires de ses figures mythiques : Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, Duke Ellington, Thelonious Monk, etc.
Nés à cette même époque, de grands festivals de jazz avaient d’autant plus contribué à relancer le genre et même sortir quelques légendes de leur retraite ou redonner du travail à la troisième division des musiciens abandonnés par l’industrie de la musique depuis le milieu des années 60 : dixieland, swing, bebop, hardbop, third stream et free-jazz pouvaient retrouver leurs publics et en conquérir de nouveaux, plus jeunes, qui abordaient le jazz comme une musique classique.
Et il y avait plus encore.
Mis de l’avant par une nouvelle génération de musiciens éduqués dans les facultés de musique, virtuoses avérés, arborant des vêtements chic comme c’est le cas des interprètes de la musique classique, le jazz acoustique pouvait atteindre des publics beaucoup plus considérables et connaître un véritable essor économique. On pense évidemment à la famille Marsalis et consorts. La consommation du jazz en salle ne se passait pas exactement comme la musique classique, cependant: le public était au rendez-vous pendant les grands festivals tenus durant la saison chaude et il prenait congé le reste de l’année, sauf exceptions.
Les promoteurs des plus grands festivals, en Amérique comme en Europe, ont alors réalisé les limites du jazz « sérieux » quant à sa capacité de conquérir les masses.
Il fallait se rendre à l’évidence, le jazz moderne était une musique complexe, savante, au même titre que la musique classique. Les formes du jazz moderne s’inspiraient certes du Great American Songbook mais en transformaient les rythmes et harmonies et n’en conservaient que les thèmes mélodiques. Et ce n’était que le début de cette forme devenue « savante ». Ce procédé de complexification était parfaitement comparable aux transformations des musiques populaires engendrées par les grands compositeurs européens depuis la Renaissance.
Plusieurs formes de jazz devenaient savantes et leurs adeptes ne représentaient pas la majorité. Sauf exceptions, le jazz ne serait pas une musique surtout populaire et ne pourrait pas attirer des auditoires de masse, encore moins de gros commanditaires pour financer ces événements en bonne partie. Les gestionnaires des grands festivals ont alors saisi que les styles de musique complémentaires au jazz, des styles forcément plus pop, étaient essentiels à l’expansion de leurs événements. C’est ainsi que le jazz « sérieux » a progressivement dû céder une part importante de l’espace en salles qui lui était consenti. Dans le même ordre d’idée, le public du jazz a vieilli, moins alimenté par de nouvelles propositions moins soutenues par l’industrie de la musique.
Où en sommes-nous aujourd’hui? Moins de jazzmen et jazzwomen « sérieux.ses » sont capables de remplir des salles payantes. Certes, il existe encore des valeurs sûres (Brad Mehldau, Joshua Redman, etc.) et de rares phénomènes jazz issus des médias sociaux (Laufey cette année, est un bon exemple), et ces valeurs sûres doivent cohabiter avec un nombre croissant d’artistes de différents styles dont ceux de la tendance néo-classique, sorte de zone intermédiaire entre la musique populaire et ladite musique sérieuse.
À tel point que des musiciens de très haut niveau, on pense notamment à Chris Potter qui est un des meilleurs saxophonistes sur Terre, acceptent de se produire sur une scène extérieure secondaire, et gratuite. Un peu comme si Charles Richard Hamelin jouait à Lanaudière sur une scène secondaire d’accès gratuit pendant qu’Alexandra Streliski remplirait l’amphithéâtre Fernand-Lindsay.
Force est d’admettre que l’économie du jazz n’est pas celle de la musique classique occidentale. Le jazz « sérieux » bénéficie nettement moins du soutien étatique et du mécénat, ce qui nuit considérablement à son maintien et à sa continuité créative.
Tous ces facteurs font en sorte que le jazz décline depuis un moment et ses nouveaux protagonistes doivent reconquérir un espace public perdu au fil des dernières décennies.
On sait aussi qu’une génération montante de musiciens liés au jazz tient à ramener le party et un esprit jeune dans l’affaire, ce qui est comparable au jazz rock des années 70 et 80. Très bien ! Sans conteste, on apprécie que Hiatus Kaiyote et Robert Glasper puissent remplir la Place des Festivals, on aime aussi découvrir gratuitement le nec plus ultra du jazz d’aujourd’hui sur les scènes Pub Molson et Studio TD, on se désole néanmoins que des musiciens de haut niveau sont aujourd’hui incapables (ou nettement moins capables) d’attirer des publics désireux de débourser comme le font les mélomanes de la musique classique.
Sans grimper dans les rideaux, il faut faire ce constat pragmatique: le jazz « sérieux » ne vend pas.
Pour l’instant, les directions d’événements hybrides à saveur jazz (ou qui en portent le nom) n’ont pas d’autre choix que de le relancer comme un produit d’appel, autrement plusieurs salles payantes seraient vides ou clairsemées. À Montréal, en tout cas, on ne lésine pas sur cette relance, au grand plaisir des connaisseurs qui se régalent sans avoir à payer. Cette programmation gratuite, on peut le dire, est la meilleure côté jazz depuis longtemps. Paradoxal ? Peut-être mais… cette situation est généralisée partout dans le monde, une dynamique amorcée il y a longtemps. Les forces du marché, n’est-ce pas ?
Que faire alors ? Déplacer le jazz « sérieux » dans les festivals et saisons de concerts classiques ou bien attendre les fruits de cette reconstruction que l’on observe cette année sur les scènes gratuites ?
Chose certaine, il faudra un jour accepter qu’une frange importante des jazzophiles, et l’on ne parle pas ici des férus de jazz groove traversé par le hip-hop, aiment les formes plus complexes et plus exigeantes, au même titre que les amateurs de musique classique occidentale. Il faudra surtout prendre conscience que les artistes du jazz « sérieux » doivent s’épanouir avec un public sans cesse renouvelé et encouragé à le faire, comme c’est le cas de la musique classique et de la musique contemporaine. Pour que le jazz « avancé » puisse revoir sa valeur marchande à la hausse comme ce fut le cas il y a 40 ans, il faudra d’autres conditions que celles prévalant aujourd’hui. Pas demain la veille…