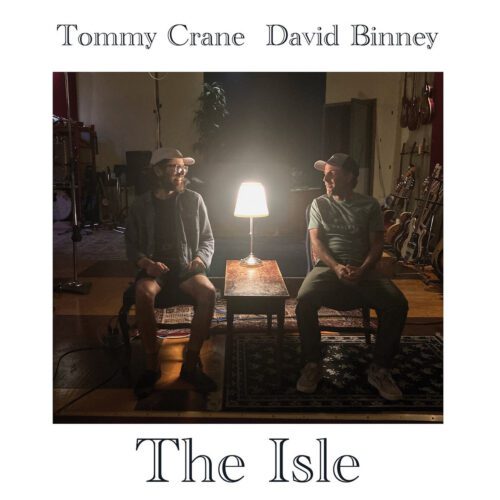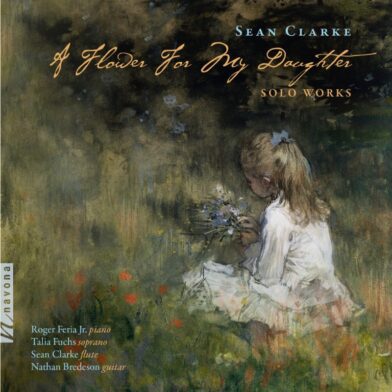Ce n’est écrit nulle part, mais il existe parmi les sous-genres du rock quelque chose que j’aime appeler « Odd Rock », une musique oblique, avant-garde, toujours orientée par la guitare et la batterie, mais qui défie les règles du jeu et élargit les frontières du genre. Dans cette catégorie pourraient se retrouver des groupes comme The Residents, The Cardiacs, Primus ou tout ce que Zappa a influencé.
Parmi les moins connus, il y a aussi eu l’excellent Sleepytime Gorilla Museum, mort et enterré depuis 2011. Du moins, c’est ce qu’on croyait, car personne ne s’attendait à voir ce groupe réémerger 13 ans plus tard avec un quatrième album, mais nous y voilà !
D’emblée, le groupe ne déçoit pas par son ambition. À l’instar de ses albums précédents, l’affaire dure plus d’une heure et quart et traverse un arc musical des plus cinématiques. Les pièces, très progressives et avec peu de répétitions, sont développées et se dirigent toujours vers l’avant. Cela n’empêche pas l’album de regorger de moments accrocheurs et saisissants. L’instrumentation y est également étendue, l’album incorporant cuivres et cordes frottées. Les moments les plus ambiants font aussi entendre des cloches et toutes sortes de voix d’arrière-plan qui contribuent aux plans multiples de cet album. Toute cette histoire est également plutôt sombre, ce qui justifie pleinement la dissonance et les moments presque métal, comme sur l’ouverture Salamander in Two Worlds.
Le chant a, comme toujours, une place prépondérante dans l’album. La voix du chanteur principal navigue aisément à travers l’angoisse, la douceur, l’agressivité et la folie. Ces évocations variées relèvent toutefois constamment d’une excentricité unique à Sleepytime Gorilla Museum. Y sont souvent superposées d’autres strates, comme les nombreuses harmonies vocales qui parcourent l’album. En contraste, une voix féminine rappelant la chanteuse islandaise Björk domine les pièces Silverfish et Hush, Hush, ce qui ouvre un tout nouveau tableau. Sur We Must Know More, c’est plutôt une ambiance de cabaret qui s’installe sur un rythme valsé et ponctué par le sousaphone. L’album parcourt ainsi diverses textures, souvent articulées par des mélodies chromatiques et des sections de batterie très techniques. Le tout fait penser à un rendu musical de l’esthétique steampunk si chère au cinéma, ce qui n’est pas sans rappeler le défunt groupe québécois Jardin Mécanique.
En somme, of the Last Human Being est une proposition plus grande que nature de la part d’un groupe qui faisait déjà dans la musique complexe et inhabituelle. La puissance et les accroches du rock y sont bien présentes, mais sont au service d’une créativité déjantée et en dérive vers une noirceur cauchemardesque. Le côté sombre de la musique progressive, en quelque sorte ! Un album inattendu, mais qui réaffirme la pertinence du groupe dans l’écosystème moderne du rock expérimental.