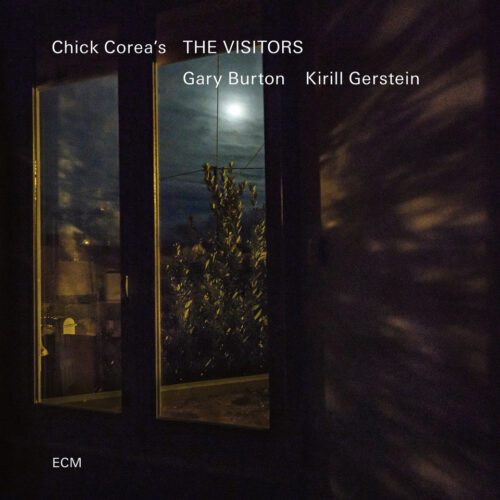Le Théâtre Plaza s’est transformé hier soir en espace déroutant, hors du temps, entre dadaïsme ‘’début vingtième’’ et jeune avant-garde ‘’début vingt-et-unième’’, pour la création du spectacle pluridisciplinaire du groupe No Hay Banda, Il Teatro Rosso – lisez notre mise en contexte via l’entrevue avec Noam Bierstone, de No Hay Banda.
Si l’inspiration première de l’œuvre signée Steven Kazuo Takasugi à la musique et Huei Lin à la mise en scène et vidéographie, est appuyée sur les vieux théâtres du début du 20e siècle, souvent bourrés de rouge capiteux (sièges, rideaux, murs, etc.), la musique, elle, n’avait rien à voir avec cet univers rétro-kitsch.
Pendant une heure approx, une partition ultra-pointilliste, interprétée avec précision par les membres de No Hay Banda avec accompagnement de bande et de vidéo, a taquiné le public à divers degrés d’intensité. Des vagues se sont succédées en crescendo-décrescendo, oscillant entre passages presque dénudés et moments de saturation sonore à la limite de l’insoutenable. Tout en égrenant des tonnes de notes, aucune ne faisant plus d’une seconde maximum, les artistes sur scène prenaient (autant que possible) des poses qui répondaient ou contredisaient celles projetées sur écran (les mêmes instrumentistes, jouant la même partition). On assistait à une sorte de décalage à la fois sonore et visuel entre le live et l’enregistrement audiovisuel. Sur scène, les musiciens étaient habillés de façon vaguement seventies meets années folles, alors que dans la vidéo, plutôt 1920-1930, mais non stéréotypée.
La musique, totalement abstraite, n’est certes pas ‘’facile’’, mais son appui sur la mise en scène et sur la relation entre le langage corporel des musiciens sur scène versus leurs doubles dans la vidéo crée une dynamique dramatique, une théâtralité, qui sait capter et maintenir l’attention.
Et cette théâtralité, raconte-t-elle quelque chose? Plus ou moins. Le programme indique une division en deux actes, Il Teatro Rosso et The Drowning. Ceux-ci sont divisés en trois et quatre scènes respectivement (The Spasms of Trapped Animals, Tar Pits, Grumpy Old Man, etc.), qui sont elles-mêmes sous-divisées. Que veulent dire ces titres exactement? Chacun et chacune y trouvera ses repères, plus ou moins explicites. Mais on pouvait, cela dit, suivre plus ou moins précisément le déroulement grâce à la gestuelle des artistes et la nature dynamique de la musique. Il y avait quelque chose qui rappelait les fulgurances créatives de Tristan Tzara au Cabaret Voltaire, accompagnées de musique bruitiste et de décors éclatés signés Arp et Janco, version post-moderne. Les esprits de Cocteau, Picabia, Schwitters ou Duchamp étaient probablement présents dans la salle montréalaise.
Au final, cet hommage aux vieux théâtres rouges, ceux des décennies d’entre-deux-guerres du 20e siècle, est aussi, en vérité, une connexion symbolique entre deux avant-gardes séparées par une centaine d’années. D’un côté, l’une des sources de tous les mouvements expérimentaux des 20e et 21e siècles : le dadaïsme des années 1920, et de l’autre, une jeune avant-garde montréalaise hyperactive et inventive (d’ailleurs bien représentée dans le public qui remplissait abondamment le Théâtre Plaza) des années 2020.
No Hay Banda :
Sarah Albu, voix; Adrianne Munden-Dixon, violon; Émilie Girard-Charest, violoncelle; Lori Freedman, clarinette basse; Felix Del Tredici, trombone basse; Daniel Áñez, piano; Noam Bierstone, percussions; Gabriel Dufour-Laperrière, sonorisation