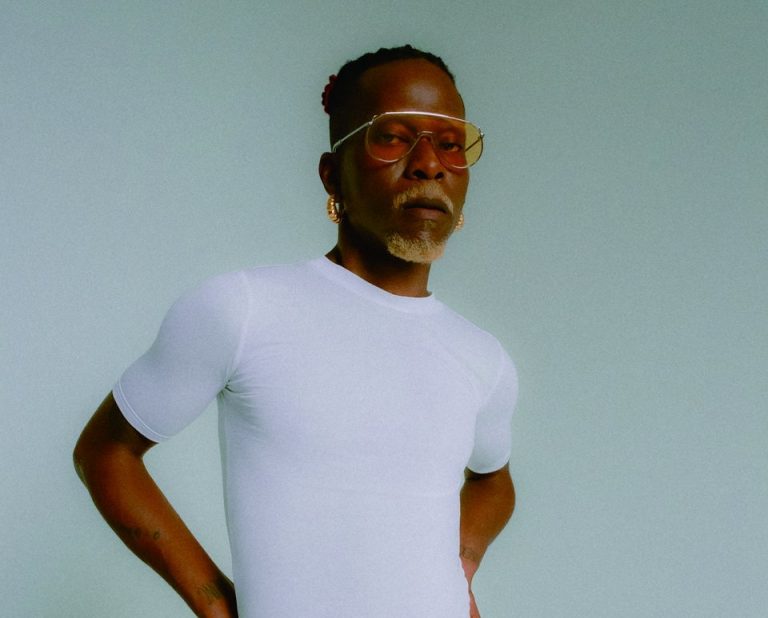Un soir de l’été 2015 à la Maison symphonique, Wayne Shorter se produisait avec cet excellent quartette qui en avait prolongé la vie créative sur scène, contre toute attente. Ce soir-là, cependant, on avait senti que c’était le début de la fin. À l’évidence, le maître n’avait plus la maîtrise absolue de ses instruments (ténor et soprano) qu’on lui connaissait même à un âge avancé, ses réparties improvisées n’étaient plus aussi alertes et circonspectes qu’elles ne l’avaient été sa vie durant, soit depuis ses débuts avec les Jazz Messengers du batteur Art Blakey.
On devinait que les sourires complices de ses acolytes cachaient une tristesse certaine, je m’étais dit alors que c’était mon dernier concert de Wayne Shorter. Le revoir sur scène ainsi diminué ? Nenni. Cet immense compositeur, improvisateur et interprète ne serait plus jamais ce qu’il avait été: pendant plus de 60 ans, l’un des plus brillants de cette musique qu’on nomme encore jazz.
Huit ans après ce triste constat de ses pertes de facultés, quelques mois avant d’atteindre le cap des 90 ans, Wayne Shorter s’est éteint. Encore aujourd’hui, le grand public et même le grand public du jazz ne le mettront peut-être au panthéon des incontournables. Personnage discret, peu loquace, néanmoins intéressant dans ses propos (pour lui avoir parlé à maintes reprises, j’en témoigne), il s’exprimait d’abord par ses accomplissements.
Ses qualités de créateur et sa curiosité intellectuelle l’ont notamment mené à changer le jazz après son âge d’or hardbop, soit en y injectant plus de musiques modernes de tradition classique occidentale et plus de musiques modales non occidentales à la lignée dont il est issu. Jusqu’aux années 50, le jazz avait certes intégré les musiques classiques post-romantique et modernes, surtout impressionnistes. Ça s’entendait avec attention, de Duke Ellington à Bill Evans en passant par premier quintette de Miles Davis, notamment dans ses collaborations avec l’arrangeur Gil Evans. Wayne Shorter, lui, témoignait d’une connaissance encore plus profonde des avancées modernes et contemporaines de la musique classique et en usait brillamment sans que ces couleurs ne l’emportent dans son œuvre essentiellement jazz.
Pourquoi Wayne Shorter est-il moins cité que les grandes icônes du style ? Fort probablement parce qu’il n’avait pas la flamboyance médiatique d’un Miles Davis dont il fut pourtant le compositeur déterminant au sein du fameux quintette des années 60 – Herbie Hancock, piano, Tony Williams, batterie, Ron Carter, contrebasse, Miles, trompette, Wayne, saxos. Sans lui, ce quintette historique n’aurait pu compter sur les compositions d’une telle apothéose acoustique: Nefertiti, Footprints, E.S.P, Fall, Pinocchio, Iris, Orbits, Dolores, Prince of Darkness, Limbo, Vonetta, Parephernalia.
Sous étiquette Blue Note, le saxophoniste menait une carrière parallèle, ses albums solo s’inscrivent dans le même esprit du Miles Davis Quintet, mais avec un impact moindre pour les raisons qu’on vient de formuler. Il faut donc écouter de nouveau ces enregistrements essentiels au jazz des années 60, particulièrement JuJu, Speak No Evil, Adam’s Apple, Super Nova. Comme il le faisait chez Miles, Wayne Shorter y traçait alors la voie post-hardbop tout restant fidèle aux thèmes mélodiques et aux harmonies consonantes pendant qu’Ornette Coleman, Cecil Taylor, John Coltrane, Pharoah Sanders, Albert Ayler et tant d’autres admettaient l’atonalité et l’arythmie dans leurs propositions.
Fin des années 60, les fameuses séances d’électrification du jazz menées par Miles Davis ont constitué la communauté fondatrice du jazz-rock rebaptisé jazz-fusion par la suite, pour le meilleur et pour le pire. Sa complicité avec le claviériste et compositeur autrichien Jozef Zawinul, concepteur central pour l’album mythique de Miles Davis, In A Silent Way, enregistrement fondateur s’il en est.
La fondation de Weather Report avec Joe Zawinul fut le prolongement le plus intéressant des premiers opus électriques de Miles (In A Silent Way, Bitches Brew, Jack Johnson, On The Corner, Big Fun). Les premiers enregistrements, Weather Report (homonyme) et Sweetnighter, étaient très proches de ce son , l’identité de la formation s’était ensuite précisée avec I Sing the Body Electric, Mysterious Traveler, Tale Spinnin’, albums dont la cote ne cessera de monter avec le temps si vous voulez mon avis. En 1976, on assistait à autre tournant avec l’opus Black Market et l’arrivée en force de Jaco Pastorius au sein de WR. Cette entrée spectaculaire du superbassiste coïncidait avec un son plus proche des musiques africaines et afro-antillaises, mises de l’avant par Zawinul et endossées par le groupe. Avancée ou édulcoration ? Avancée au début, édulcoration par la suite…
D’aucuns déploraient alors la posture trop effacée de Shorter en tant que soliste et leader conceptuel, posture qu’il conserva jusqu’à la fin du groupe. Les choses s’étaient progressivement gâtées avec des albums vraiment trop sucrés, soit après la sortie de l’opus Heavy Weather en 1977, certes le plus connu de la discographie WR. Par la suite, on assista au déclin, soit jusqu’en 1985 avec la sortie du très quelconque Sportin’Life.
S’ensuivit une renaissance de Wayne Shorter en tant que leader et compositeur, pendant que Zawinul poursuivait l’oeuvre de WR en embauchant plusieurs virtuoses non occidentaux – le batteur ivoirien Paco Sery, le bassiste mauricien Linley Marthe, le bassiste camerounais Richard Bona, etc.
De la mi-70 jusqu’à sa mort, le génie de Wayne Shorter fut progressivement reconnu par les jazzophiles de toutes tendances, du champ gauche au champ droit.
Cette reconnaissance s’imposait d’abord avec le mémorable Native Dancer sorti en 1974, un album mettant en vedette le chanteur brésilien Milton Nascimento et dont le concert donné à Montréal beaucoup plus tard, soit à la fin des années 80, fut l’un de ses plus éblouissants. Les albums Atlantis (1985), Phantom Navigator (1986), Joy Rider (1988) et High Life (1994) furent les prolongements shorteriens d’une esthétique tributaire de Weather Report mais sans l’impulsion afro-pop de Zawinul – qui avait atteint ses limites.
Au tournant du millénaire, il était permis de croire que tout avait été dit par chaque entité du fameux tandem à l’origine de Weather Report.
Or, Wayne Shorter se préparait à nous offrir de grandes surprises en constituant un nouveau quartette acoustique, fondé essentiellement sur l’improvisation en temps réel: Danilo Perez, piano, Brian Blade, batterie, John Patittuci, contrebasse. La contribution de ce quartette dépassa largement les attentes, des concerts mémorables se sont enchaînés jusqu’au déclin annoncé en 2015. Ici et maintenant, le leader intégrait les moult thèmes et progressions harmoniques de ses compositions engrangées dans sa boîte crânienne. On retient les albums Footprints Live! (2001), Alegria (2003), Beyond the Sound Barrier (2004), Without A Net (2010). Et l’on ne compte pas les travaux de Shorter dans la musique de chambre, un angle qu’on aurait voulu plus nourri étant donné les résultats probants.
Exemplaire, remplie à souhait, cette existence créative de Wayne Shorter, un adepte du bouddhisme nichiren, fut marquée par quelques tragédies, soit la courte vie d’une enfant lourdement handicapée et la mort prématurée de sa deuxième épouse Ana Maria, dans un accident d’avion. À ce titre, le musicien fut fidèle à lui-même, très discret publiquement sur ce qui , somme toute, ne nous regarde pas. Côté Wayne, ce qui nous regarde… s’entend.
Pour un plongeon rapide dans l’univers de Wayne Shorter, découvrez notre sélection PAN M 360 de 10 albums essentiels de sa discographie