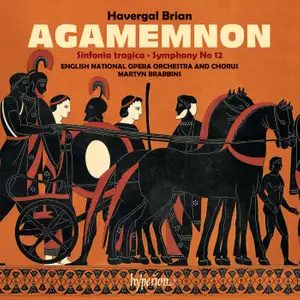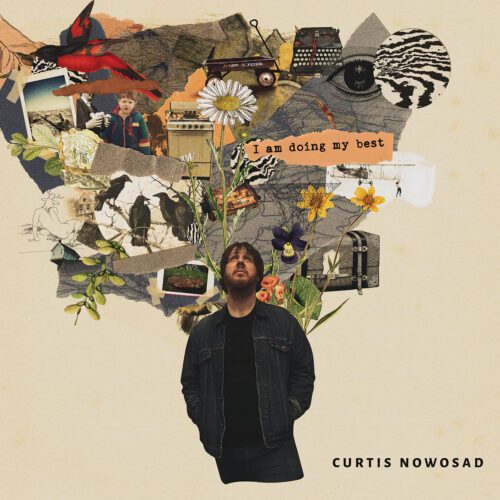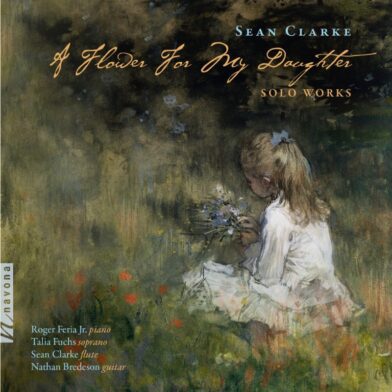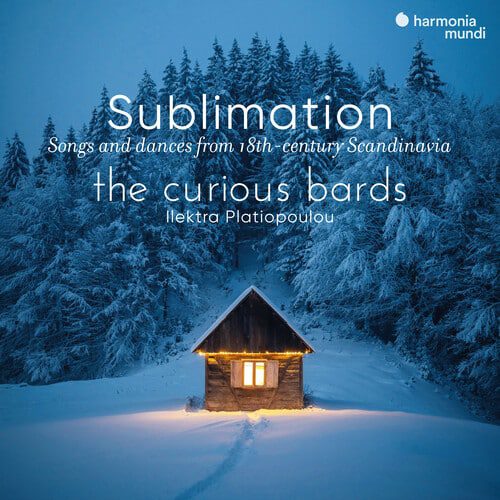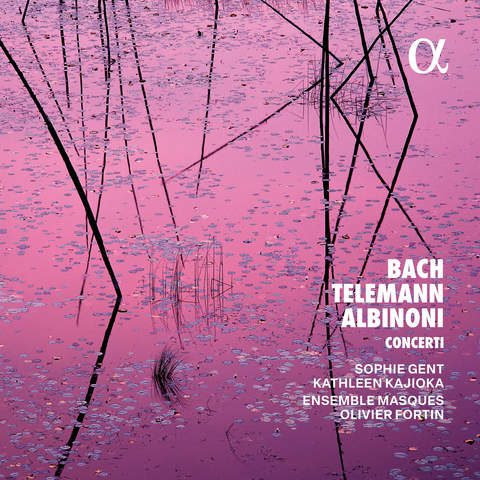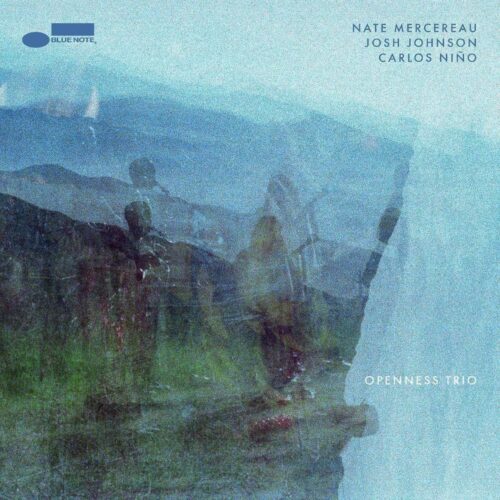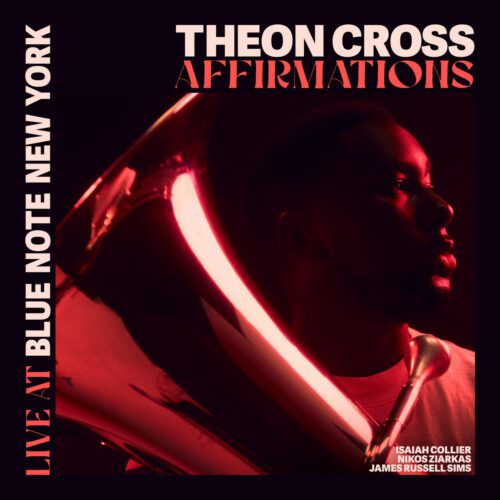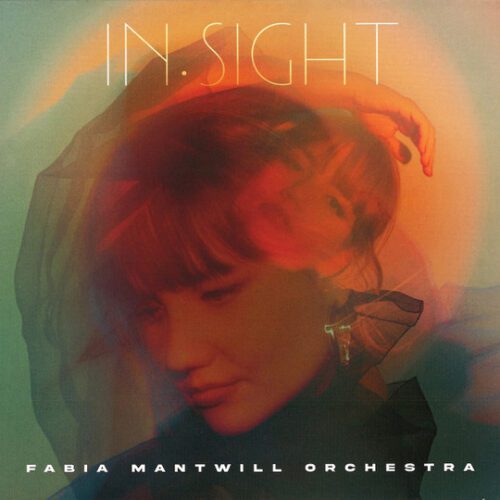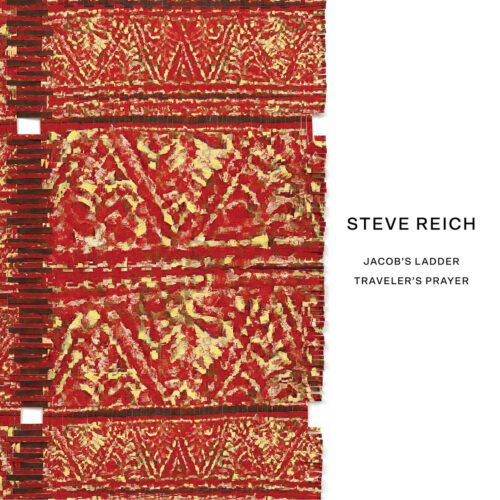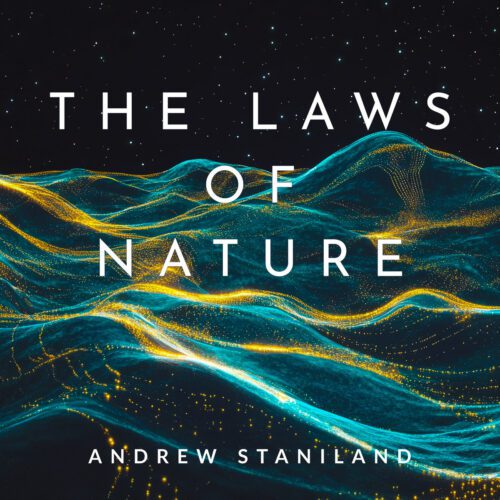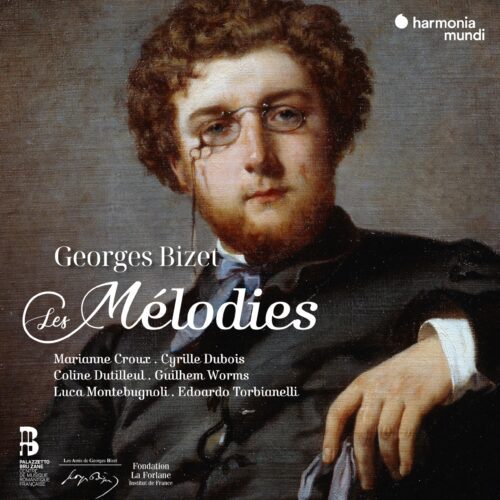Pour les amoureux d’orchestrations foisonnantes mais également raffinées et remplies d’idées et de surprises, la musique du Britannique Havergal Brian (1876-1972) sera une source de satisfaction durable. Son œuvre la plus ‘’connue’’ est la monumentale Symphonie gothique, qui dure presque deux heures. Depuis, sa réputation est celle d’un compositeur de la démesure. Ce qui est faux. La Gothique est une exception plutôt que la règle. La plupart de ses partitions sont de dimensions temporelles tout à fait raisonnables. Par exemple, les deux symphonies présentées ici, qui font chacune environ 20 minutes. Ce qui ne change pas, cela dit, c’est la qualité de l’écriture orchestrale de Brian. On pense à Mahler, on pense à Prokofiev, on pense à Britten, mais on se rend vite compte qu’on est ailleurs, car Brian a une personnalité forte et affirmée.
Sa marque est celle de grands gestes amples et panoramiques, sur fond d’harmonies chromatiques, parfois modales, sur lesquelles il brode de nombreux motifs mélodiques ou simplement coloristes qui surprennent et ravissent plus souvent qu’autrement. Brian utilise l’ensemble de l’orchestre de façon hyper détaillée (d’où l’erreur de certains qui l’ont comparé à Bruckner, car ce dernier fonctionne plutôt par larges et massifs applats sonores), instrument par instrument, section par section, avec des tutti qui ne s’éternisent pas. Sa musique est également très active, propulsée par une énergie intrinsèque palpable et excitante, malgré des moments de tranquillité qui peuvent être délicats et très séduisants. Ici, je pense un peu à un autre Anglais moderne, Robert Simpson.
Brian a toujours manifesté le plus vif intérêt pour la dramaturgie. Il aimait l’opéra (il en a écrit cinq) et la littérature. Il disait que la plupart de ses œuvres symphoniques jaillissaient d’une source littéraire ou dramatique quelconque. C’est le cas des deux symphonies de cet album magnifiquement enregistré et interprété par l’orchestre de l’Opéra national anglais.
La Sinfonia tragica (la sixième du catalogue de Brian, qui en comprend 32!) provient d’un projet d’opéra jamais abouti. Le prélude envisagé est devenu une symphonie, cette tragica frémissante d’une vie intérieure active. Imaginez que Brian l’a écrite à l’âge de 72 ans! Il allait donc en écrire 26 autres avant de mourir. C’est une partition d’un seul tenant, comme la Septième de Sibelius, par exemple. Son caractère dramatique transparaît d’un bout à l’autre, depuis les premières mesures qui évoquent une cavalcade nocturne et mystérieuse, jusqu’à la surprenante conclusion, en passant par des épisodes de beauté pastorale bien anglaise, puis par des moments d’introspection mélancolique et de rebonds dynamiques abrupts. Tout cela dans un écriture fine, chambriste mais riche et veloutée.
J’aimerais pouvoir vous décrire à la hauteur de mes impressions la qualité esthétique de cette musique. Je me contenterai de vous suggérer d’écouter simplement le premier mouvement de la Sinfonia tragica, en bas de la page. Vous serez rapidement convaincu et séduit.
La Symphonie no 12, comme la Tragica a été écrite comme le prélude d’un opéra, celui-ci bien réel : Agamemnon, dont je vous parlerai tout de suite après. Plus sombre mais tout aussi pétillante de contrastes et d’énergie narrative, la douzième est l’oeuvre d’un artiste de 81 ans, qui lance avec celle-ci la dernière partie de sa vie professionnelle : un rush créatif inédit en musique moderne avec l’écriture, par un octogénaire et dans la dizaine d’année qui allait suivre, d’une vingtaine de symphonies! Ultra concise, cette symphonie rassemble en moins de dix minutes une impressionnante panoplie de textures et de thèmes contrastés. Un petit tour de force.
Agamemnon, l’opéra qui est techniquement la raison d’être de la Symphonie no 12, reprend le mythe du meurtre du roi de Mycènes après son retour de Troie, par sa femme Clytemnestre et l’amant de celle-ci, Égisthe. Une quarantaine de minutes, si on lambine un peu, Agamemnon pourrait servir de mise en contexte pour l’Elektra de Strauss. Le matériau musical est certes plus angulaire et abrupt que la partition de Strauss, mais il en ferait tout de même un compagnon approprié.
Esthétiquement, bien que les harmonies changeantes et le style vocal ne s’éloignent pas outrageusement du chef-d’oeuvre de Strauss, les couleurs sonores utilisées font plus souvent appel au vents et à des phrases nervurées, urgentes, que la somptuosité ténébreuse des cordes et cuivres d’Elektra. Cela dit, comme chez Strauss, Brian (en bon héritier de la société victorienne) campe le personnage de Clytemnestre dans la négativité, ignorant presque entièrement les raisons qui l’ont poussée à assassiner Agamemnon : le sacrifice par ce dernier de leur fille Iphigénie, donnée en holocauste aux dieux pour favoriser sa victoire sur les Troyens. Dans la société masculiniste de la Grèce antique, comme dans celle du 19e siècle victorien, la femme comptait pour peu. Sacrifier une jeune fille aux dieux peut se justifier, mais assassiner un roi, même par une mère éplorée, reste inacceptable. Il serait temps de revisiter ces mythes sous des aspects plus féministes, et remettre ces reprochables messieurs à leur place!
Agamemnon, musicalement parlant, est plus touffu, plus exigeant que les deux symphonies précédentes, voire carrément austère. Les lignes vocales ont souvent tendance à être séparées de l’accompagnement orchestral, ce qui ne les rend pas simples à suivre. Agamemnon ne sera pas la meilleure introduction à l’univers de Brian, mais si vous êtes déjà un peu plus familier avec lui, ça vaudra la peine d’y jeter une oreille attentive. Qui plus est, selon tout vraisemblance, il s’agit du seul enregistrement professionnel disponible à l’heure actuelle.
Les solistes sont adéquats, sauf le ténor Robert Murray dans le rôle du Watchman (le Veilleur), qui surutilise un vibrato désagréable.
Pour les curieux et curieuses, la musique de Havergal Brian fournira des moments d’écoute stimulants et complexes.