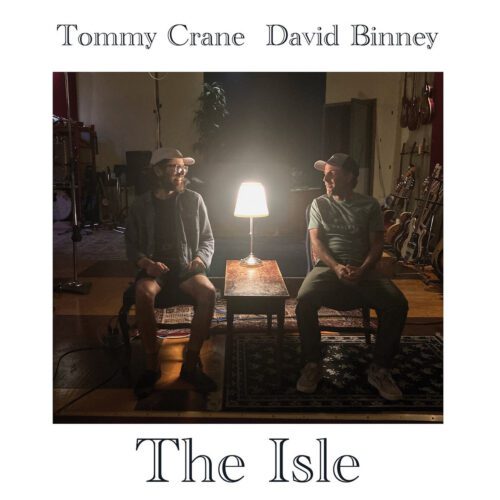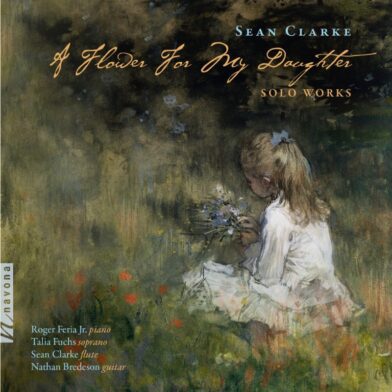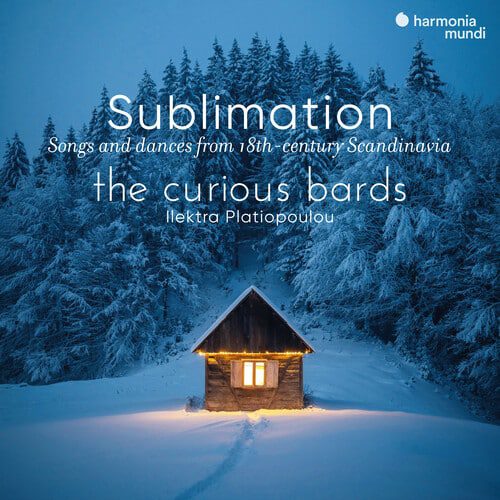Les géants britiches du métal sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Nos collaborateurs Christine Fortier et Luc Marchessault commentent tous les deux leur nouvel opus.
Commençons par l’évidence : Iron Maiden ne se réinvente pas avec son 17e album, mais est-ce vraiment nécessaire d’être dépaysé quand le voyage est si agréable? À 1 heure 22 minutes, Senjutsu (« tactique et stratégie » en japonais) est une méga-épopée musicale à absorber, mais le fait qu’on est en territoire connu la rend plus facile à apprivoiser et à aimer. Les guitares acoustiques, très présentes sur Lost in a Lost World, The Time Machine, Death of the Celts, The Parchment et Hell on Earth, donnent encore plus d’envergure aux montées en puissance, qui laissent ensuite place aux mélodies galopantes constituant la marque de commerce du sextuor britannique. Depuis Brave New World (2000), le progressif fait partie de l’arsenal qu’utilise Iron Maiden pour créer des atmosphères introspectives. On entend une influence southern-rock sur The Writing on the Wall, tandis que la capacité du groupe à livrer des chansons épiques, même si son rythme est généralement plus lent, est intacte. (Christine Fortier)
L’an de grâce 1975 tirait à sa fin, en banlieue londonienne, quand Iron Maiden naquit du cerveau de Steve Harris. Un mois et demi plus tôt, les Sex Pistols s’étaient produits sur scène pour la première fois. Margaret Thatcher était cheffe de l’opposition et ne recevra son sobriquet de « Dame de fer » que l’année suivante. Début septembre 2021, presque 46 ans plus tard, Johnny Rotten est désormais trumpiste, l’Iron Lady sirote depuis longtemps son sherry avec Pinochet en enfer… et Iron Maiden lance Senjutsu, son 17e album studio. Eddie brandit un katana sur la pochette, comme sur celle de l’album live Maiden Japan paru en 1981.
Le bassiste Steve Harris, le guitariste Adrian Smith et leurs compères compositeurs tirent encore fois des combinaisons inédites de leur intarissable mine de possibilités mélodiques, harmoniques et rythmiques. En résultent dix trames architecturées et texturées à la Maiden, de la plus courte (4 min 59 s) à la plus longue (12 min 38 s). Lorsqu’il a écrit « N’entends-tu pas toutes les guitares – Criant de joie dans la chevauchée? » en 1962 (La légende du cheval blanc), Claude Léveillée n’aurait pu songer à Iron Maiden. Pourtant, ces vers illustrent parfaitement la cavalcade des guitaristes Dave Murray, Janick Gers et Adrian Smith sur Death of the Celts.
Depuis au moins The Number of the Beast en 1982, ce qui coïncide avec l’arrivée de Bruce Dickinson au micro, on a l’impression que Maiden structure ses pièces en s’inspirant autant des marches militaires de John Philip Sousa que des modèles habituels des pionniers du métal. On retrouve notamment cette esthétique « sousienne » dans les mouvements 1 et 2 de Hell on Earth. Ajoutons à cela la scansion de Dickinson – dont les cordes vocales n’ont rien perdu de leur élasticité –, sa manière hiératique de déclamer des textes portant sur les thèmes récurrents du biotope d’Iron Maiden : confrontation du Bien au Mal, moyen-âge, cyborgs, voyages dans le temps, guerre et paix, mythologies, légendes et prophéties.
Iron Maiden n’a pas son pareil pour créer des hymnes. The Writing on the Wall est en d’ores et déjà un, qu’entonnent sans doute les fans de Djakarta à Canberra, de Pretoria à Ankara, de Tirana à Sintra et de Brasilia à Saint-Gérard-Majella. Lors de la prochaine tournée du groupe, les maiden-heads réciteront solennellement, avec le célébrant Dickinson, les vers touchants qui concluent Lost in a Lost World. Depuis le temps, Maiden s’est indubitablement fait déborder par certains de ses héritiers sur le flanc de la complexité des musiques, de la rapidité d’exécution, de la puissance et de l’agressivité. Toutefois, à la question « Combien de formations métalliques peuvent rivaliser avec Iron Maiden sur le plan de l’influence, de la constance, de la pertinence, de la popularité et de la longévité », on répondra « Aucune ». (Luc Marchessault)