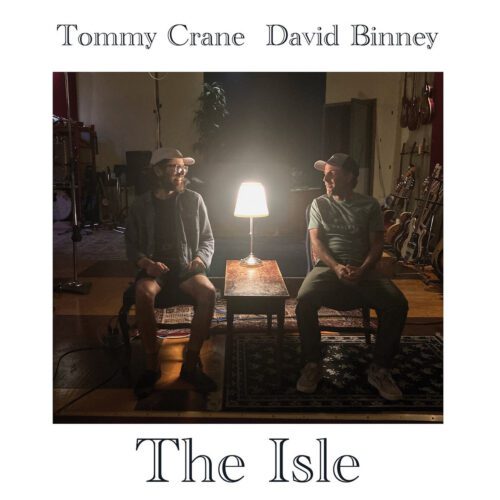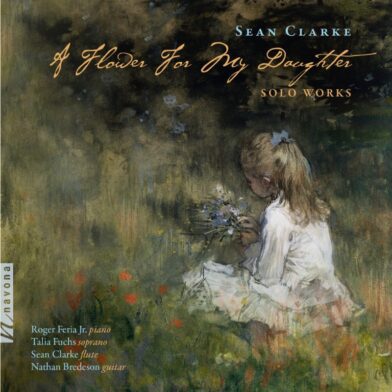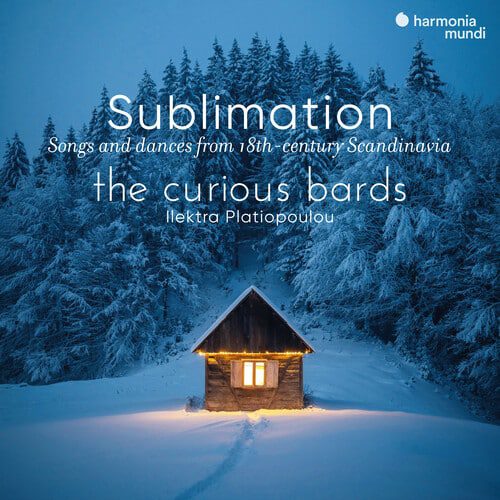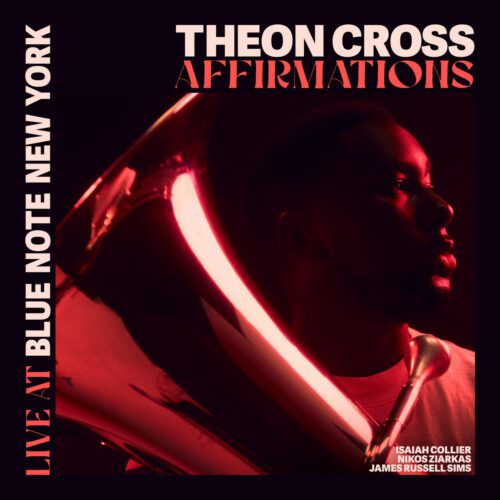Ce Requiem op. 63 de Sir Charles Villiers Stanford (1852-1924) est une rareté sur disque. Il y a eu un enregistrement pionnier sous étiquette Marco Polo (plus tard réédité chez Naxos) il y a plus de 25 ans, avec des forces irlandaises. Une bonne version, mais désormais largement dépassée par celle-ci, de la très british Birmingham, là où d’ailleurs le Requiem fut créé en 1897.
Martyn Brabbins et ses très belles forces locales (les University of Birmingham Voices et le City of Birmingham Symphony Orchestra) ont une affinité étroite avec ce genre de musique, solidement romantique, brahmsienne avec tendance française dans certains jeux de couleurs. L’orchestre ruisselle pleinement sous la baguette de Brabbins et le chœur resplendit. Les solistes (Carolyn Sampson, soprano; Marta Fontanals-Simmons, mezzo-soprano; James Way, ténor; Ross Ramgobin, baryton) ont du caractère et une fine possession du discours souhaité, fait d’un lyrisme affirmé mais empreint d’une indéniable retenue spirituelle.
Cela est important car l’essence de cette messe catholique mise en musique par le protestant Stanford est toute là : dans cet amalgame de grandeur et de sobriété. La grandeur est certainement issue du rituel catholique lui-même (porté vers la démesure) et des autres requiem composés auparavant (Mozart, Verdi, Brahms), ainsi que de la fibre lyrique de Stanford (il a écrit pas moins de 9 opéras). La sobriété, elle, vient du protestantisme de Stanford, mais également de son expérience dans l’écriture d’hymnes anglicans. On se retrouve avec une œuvre écrite pour des forces imposantes, tant vocales qu’instrumentales, mais dont on fait un usage parcimonieux, avec très peu d’éclats ostentatoires, aucune explosion sonore terrifiante comme chez Verdi et beaucoup de lumière, une lumière douce et bienfaisante.
L’écriture de Stanford se concentre sur la clarté des thèmes et des lignes mélodiques. Il a très rarement recours aux tutti massifs, et quand ceux-ci arrivent, c’est au bout de crescendos soutenus qui préparent graduellement l’auditeur. Le Tuba mirum, le Quam olim abrahae promisisti (une énergique fugue) et le Sanctus en sont les meilleurs exemples, avec ce dernier rayonnant de séraphisme et de chaleur. Ici, une opulence finement équilibrée plutôt qu’un déferlement musclé.
Ailleurs, et en vaste majorité dans les quelque 75 minutes que durent l’œuvre, on a droit a des passages tendres et mesurés, où les cordes ont souvent comme tâche de frémir doucement sous des chœurs angéliques, nous amenant dans des considérations contemplatives et célestes. Ce Requiem ne se complaît jamais dans des ténèbres menaçantes. Il fait le choix de l’espérance et de la rédemption. On y souligne le renouveau plutôt que la damnation.
Sans avoir la même poésie instrumentale, le Requiem de Stanford a indéniablement certains atomes crochus avec celui de Fauré. Il devrait d’ailleurs plaire aux amoureux de ce dernier. Propulsé par une telle qualité d’interprétation et par une prise de son ample et généreuse sans perte de détails, voilà une très belle découverte à faire.