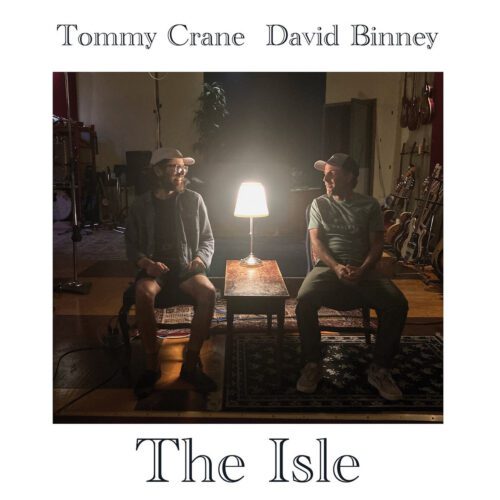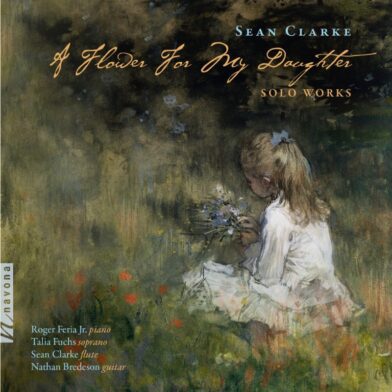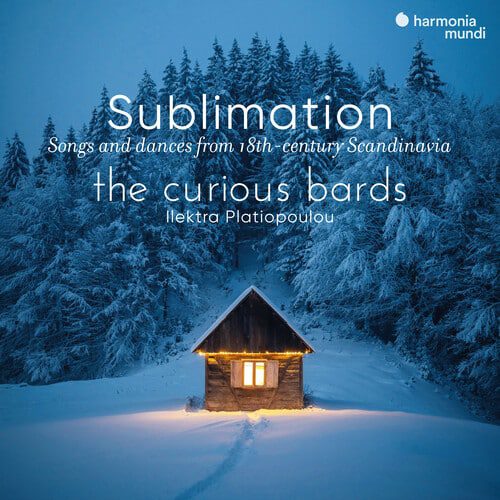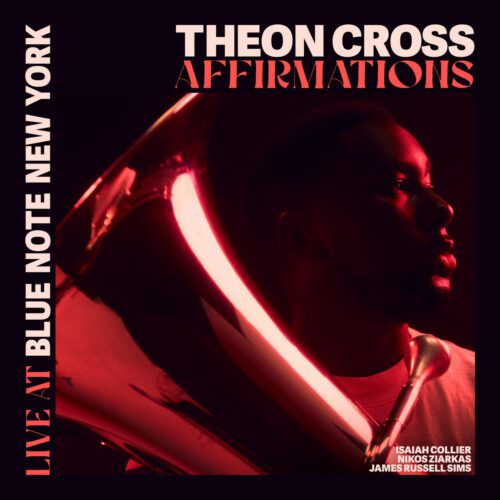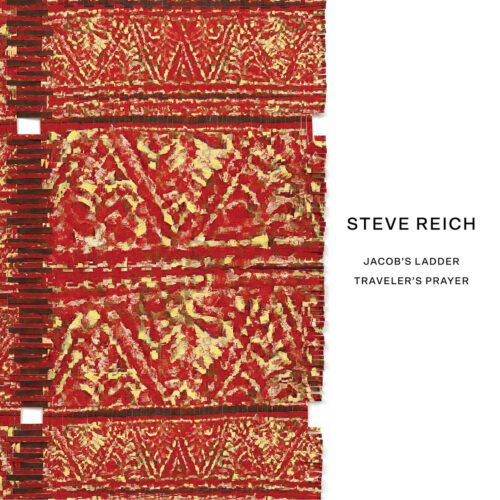Architecte sonore sans pareil, Drew McDowall s’est entouré d’un trio d’instrumentistes chevronnés (contrebasse, violon et harpe) de même que d’une pléthore d’artistes invités d’horizons divers.
Le résultat en est sidérant. Agalma I entame l’album et le clôt, cette fois augmenté par le chant sublime de Maralie Armstrong-Rial. De petites touches impressionnistes dessinent une mélodie en apesanteur à laquelle s’ajoute le jeu de la basse continue, très prenante, presque oppressante, dont le tempo se dérègle comme une boîte à musique. Sur Amalga II, la présence angélique de Caterini Barbieri, formant des chœurs divins, jure avec la musique saccadée. La voix droite et digne de Robert Aiki Aubrey Lowe devient glauque sur Agalma III, où les bourdonnements incessants de l’électronique finissent par raviver les cordes. Celui-ci performe également sur Agalma IV, mélange de salves et de statisme. Agalma VII, grandiose et dense, véritable odyssée, combine les talents du chanteur saoudien MSYLMA, du producteur égyptien Bashar Suleiman et de l’improvisatrice et artiste sonore galloise Elvin Brandhi.
Bien que ces sonorités quasi théologiques soient inédites dans sa discographie personnelle, faite d’ambient savamment cousu d’industriel, on ne peut que les rapprocher de certaines pièces du répertoire de Coil à l’élaboration desquelles il a participé (A Cold Cell, pour ne nommer qu’elle) ou non (Going Up, qu’Amalga I rappelle de troublante façon). À l’écoute, Arvo Pärt nous vient aussi en tête. McDowall présente ainsi sa version des profondeurs, faite de jeux d’équilibre entre angoisse et recueillement. Une cohésion émerge de ces dualités bien campées.
Voilà assurément l’œuvre de maturité qu’il nous fallait pour nous élever en ces temps incertains.