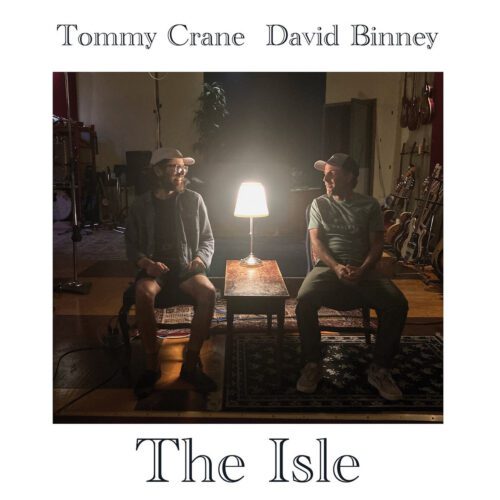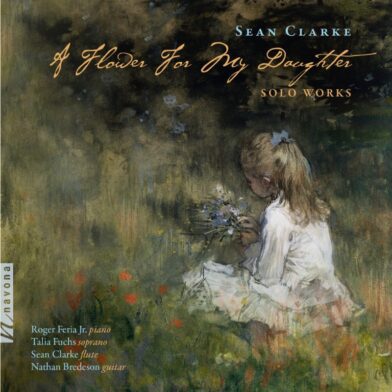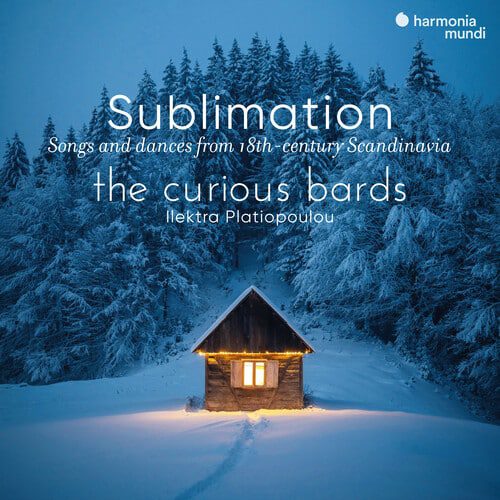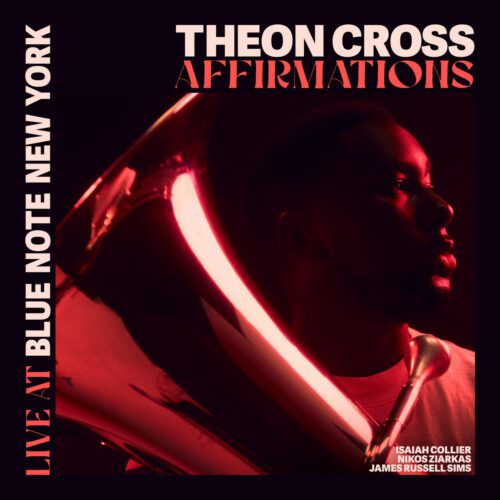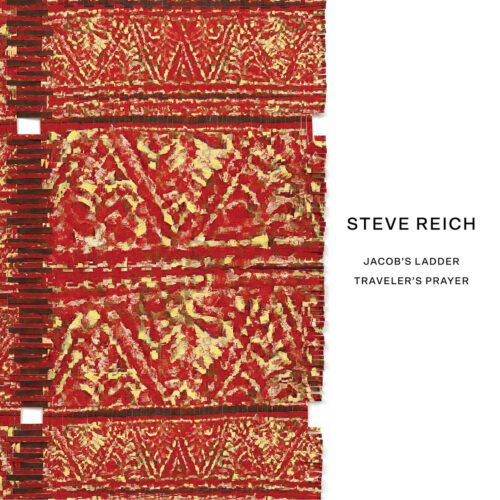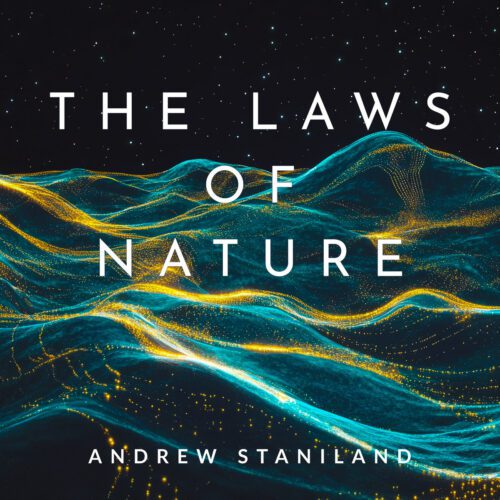Au Festival International de Jazz de Montréal, les experts de PAN M 360 assistent aux concerts qui secouent les mélomanes. Suivez notre équipe !
Robert Plant et Alison Krauss: la grande classe !

crédit photo: Victor Diaz-Lamich
Il faut le souligner de nouveau: très peu nombreux sont les artistes populaires capables de nourrir leur inspiration jusqu’au bout de la route, et Robert Plant est de ces rarissimes figures emblématiques à avoir réussi cet exploit. Vendredi soir à la Salle Wilfrid-Pelletier, un concert de très haute tenue en faisait encore l’éloquente démonstration : le superbe tandem formé avec l’artiste americana Alison Krauss et une formation d’exception.
La longévité de Robert Plant tient aussi à la cohérence de sa démarche, une vie durant. Rappelons-nous que Led Zeppelin fut au départ un groupe britannique essentiellement inspiré par le rock’n’roll, le blues et le folk américains, avec cette particularité de muscler considérablement la proposition via les transes générées par les rythmes très lourds de feu John Bonham, les riffs acidulés du guitariste Jimmy Page et de la voix paroxystique de Robert Plant. On se rappellera aussi de l’usage inspiré de référents orientaux et d’arrangements brillants du bassiste John Paul Jones, inspirés de la musique classique moderne occidentale.
Tout ça était perceptible vendredi soir (sauf la musique classique), mais dans un contexte fort différent. La formation réunissait des musiciens américains de haute volée, crème de la crème americana – Jay Bellerose, batterie, Stuart Duncan, banjo, violoncelle, mandoline, Viktor Krauss, basse, guitare, JD McPherson, guitare et concert d’introduction, Dennis Crouch, contrebasse. Sans conteste, cette instrumentation était propice à tous les croisements entre les éléments constitutifs de la musique populaire américaine, et aussi à de brillantes adaptations de Led Zep.
Tour à tour, on a entendu les reprises en tandem de Rich Woman (Lil’Millet), Fortune Teller (Benny Spellman), Can’t Let Go (Randy Weeks), The Price of Love (Everly Brothers), suivies d’une parfaites relecture ledzeppienne, soit Rock and Roll et une reprise inspirée de Please Read the Letter (Plant et Page) On a poursuivi avec High and Lonesome (Plant et T Bone Burnett), Trouble With My Lover (Allen Toussaint & Leo Nocentelli), In the Mood (Plant), puis une paire de chants traditionnels avec paire de solistes, soit Marty Groves et Gallows Pole avant de filer vers la conclusion, avec une magnifique adaptation orientalisée d’une chanson folk ledzeppienne, The Battle of Evermore. On fermera les livres dans le ravissement total avec When the Levee Breaks (Memphis Minnie et Kansas Joe McCoy).
Un demi-siècle après avoir atteint les cimes du rock, Robert Plant n’a jamais abandonné ces référents et pourtant, il est le seul membre de Led Zep à cheminer dans la grande création – quoique John Paul pourrait être encore pertinent.
Ainsi, depuis une quinzaine d’années, Plant explore les fondements de la culture americana comme peu de Britanniques l’ont fait à un tel niveau – blues, rock, bluegrass, R&B louisianais, folk, country, musiques des Appalaches, etc.. Il le fait en Amérique du Nord comme en Europe, on a tour à tour applaudi Band of Joy (2010), Lullaby and the Ceaseless Roar (2014), Carry Fire (2017) mais… Raising Sand (2007) et Raise the Roof (2021), ses deux albums en duo avec Alison Krauss ont obtenu le plus d’impact. On peut comprendre car Raising Sand est en quelque sorte la porte d’entrée de ce cycle extraordinaire. Inutile d’ajouter qu’Alison Krauss, une chanteuse et violoniste exemplaire pour son allégeance esthétique au country-folk-américana et aussi au violon traditionnel, forme un duo idéal avec l’ex-frontman de Led Zep.
Et c’est exactement ce qu’on a observé vendredi soir au FIJM, soit encore plus qu’en 2011 lorsque Plant s’était produit façon americana à la PdA avec l’inspiré et compétent Buddy Miller à la direction musicale. Quoique… ce fut excellent il y a 12 ans. C’est dire la pérennité du chanteur anglais, parmi les plus grands à n’en point douter.
Alain Brunet
TEKE::TEKE, tous les éléments réunis pour une grande célébration de créativité

crédit photo Frédérique Ménard-Aubin
Lors de notre récente interview avec TEKE::TEKE, le groupe était un peu inquiet d’attirer suffisamment de monde pour assister à sa représentation au FIJM. En fait, ils n’avaient vraiment rien à craindre. Jouant devant une salle comble au Club Soda, cette soirée était une célébration de ce groupe montréalais absolument unique, devant un public constitué de nombreux fans et de sa famille élargie.
Le septuor s’est hissé cérémonieusement sur scène avec une musique de film en toule de fond. Donner le ton avec Gotoku Lemon – une excellente introduction à leur art-rock immergé dans le monde sonore eleki – toute apparence d’hésitation a rapidement disparu, et le groupe a contaminé le public. Nous allions choper un virus très spécial !
Maya Kuroki, la sirène aux manettes, manifeste une présence scénique envoûtante. Vêtue d’un costume traditionnel japonais, elle portait de sa voix tout le poids du folklore ancien, perçant le voile entre réalité et imaginaire. Elle dansait et se balançait, entraînant toute la congrégation dans un état de transe . « Ce soir, nous sommes tous des fantômes », a-t-elle lancé au mégaphone. Touche particulièrement sympa !
Derrière Kuroki, le sextet a rapidement puisé sans ses arrangements cinématographiques, uniques et funky, le programme se voulait une vitrine pour le nouvel album Hagata. L’énergie que ces artistes apportent est vraiment épidermique et on aime que le groupe y confère une théâtralité singulière. Ainsi Teke::Teke a monté un spectacle dans le plus pur sens du terme.
Cette musique est une authentique célébration de la créativité, de l’expérimentation inter-genres et interculturelle, et faire partie de cette célébration était un privilège.
Varun Swarup
Badnadnotgood: « expérience audiovisuelle »pas vraiment mauvaise… et pas vraiment bonne

crédit photo: Benoît Rousseau
Ce n’était pas vraiment mauvais… et pas vraiment bon. Il s’agissait de BADBADNOTGOOD, le trio de jazz instrumental monstrueux et changeant, bien qu’il ait joué en live en tant que cinq musiciens sur la scène principale du FIJM. Le set a commencé par un enregistrement de War Pigs, beaucoup trop fort, avant que le bassiste Chester Hansen n’enclenche sa pédale fuzz. Le début ressemblait plus à un concert de doom rock qu’à un concert de jazz et la foule semblait un peu bizarre, mais une fois que le reste du groupe – Alexander Sowinski à la batterie, Leland Whitty au saxophone et aux guitares, Felix Fox aux clés et Juan Carlos aux percussions – est arrivé, le spectacle a pris forme et ils ont plongé dans Signal From The Noise, tiré de leur dernier album, Talk Memory.
Cette fois-ci, le groupe torontois est venu avec un fantastique fond de film 16 mm, qualifiant le spectacle d’expérience audiovisuelle à plusieurs reprises. Depuis 2019, Matthew Tavares, membre fondateur du groupe, n’est plus au clavier et a été remplacé par Felix Fox, un claviériste tout aussi mesuré, mais les trois membres restants ont été les principales vedettes du spectacle, chacun prenant ses propres solos improvisés et groovy entre les chansons de l’album Talk Memory. Sowinski a joué le rôle de « hype man », incitant le public à sauter, à applaudir et à « woo » à certains moments précis.
Il y a eu quelques hommages improvisés à la chanteuse brésilienne Gal Costa et MF Doom, qui ont fait vibrer la foule, mais rien de comparable à l’interprétation de Lavender de IV, sans doute leur album de jazz le plus abouti et le plus accrocheur.Je dirais que Talk Memory est une expérience plus agréable en live que sur l’enregistrement, et bien que le set consistait principalement en cela et que j’espérais plus d’IV et peut-être quelques interprétations de Sour Soul, c’était quand même un show mémorable.
Stephan Boissonneault
L’OVNI FELP atterrit sur l’Esplanade

Le multi-instrumentiste et réalisateur originaire de Besançon a balancé son récent album HELP ainsi que d’autres surprises sur la scène Club Montréal TD.
Après une longue intro atmosphérique aux tons de clavier-basse et saxophone ondulants, Félix Petit prend l’arrière-plan et laisse se produire un à un les invités figurant sur son album. Laurence-Anne vient interpréter la sinistre Dino, dont la propulsion du refrain semble toujours surgir de nulle part. Ensuite, au tour d’une Klô Pelgag, d’une nonchalance rêveuse, d’interpréter Babyfoot, chanson glaciale qui demande une telle attitude. Greg Beaudin, HAWA B, le rappeur de Besançon Miqi O, la tête du groupe Bellflower Em Pompa, tous et toutes se sont succédés au micro.
Le concert est devenu étonnant à partir de la moitié, alors que Félix Petit et ses musiciens ont entrepris de jouer un segment instrumental. Ce qu’on pensait être un simple interlude n’a cessé de se métamorphoser. La musique alternait entre des rythmes plus roc(k)ambolesques les uns que les autres. À la fin de ce pot-pourri d’environ dix minutes, on oubliait presque qu’il restait encore un dernier invité au programme, mais on se l’est rappelé bien vite… car Hubert Lenoir a volé la vedette illico ! Il a brillé, déchiré et pris le contrôle de la scène pour une finale tout simplement énorme. Difficile de le voir comme artiste invité, lui.
Bien que le contexte live ne permette pas autant de détails que ce que HELP offre dans nos oreilles, ce spectacle, avec son équipe d’étoiles, était vraiment digne du plus grand festival de jazz au monde.
Théo Reinhardt
Mali Obomsawin: la renaissance autochtone passe aussi par le jazz contemporain

crédit photo: Pierre Langlois
Puisque nous sommes encore en pleine renaissance de la culture autochtone, toute nouvelle manifestation de créativité titille notre curiosité et celle de la contrebassiste, chanteuse, compositrice, improvisatrice et leader abénakie Mali Obomsawin n’y fait pas exception.
On devinera que le Studio TD était plein pour ce premier concert de la musicienne venue en sextuor : Magdalena Abrego (guitare), Scott Bevins (trompette), Allison Burik (clarinette), Noah Campbell (saxophone), Zack O’Farrill (batterie), Mali Obomsawin (contrebasse et chant).
La leader de l’ensemble a grandi dans le New Hampshire mais connaît fort bien Odanak, fief de la nation Abénakie planté près de la rivière Saint-François et non loin du lac Saint-Pierre. Elle s’exprime en angais et en abénaki, elle est clairement à fond dans l’affirmation de son identité autochne, qu’elle assortit d’une critique acerbe (et parfaitement légitime) du colonialisme blanc et de l’oppression catholique.
Musicalement, ce désir d’actualisation de l’héritage culturel autochtone dans un contexte jazz se traduit par une esthétique contemplative, parfois ponctuée de secousses et éruptions. Des chants autochtones sont ici des vecteurs mélodiques autour desquels les improvisations, parfois mélodiques, parfois atonales, s’élaborent doucement en temps réel, sur tempos généralement lents. La complainte, la colère mais aussi la fierté et l’espoir se manifestent dans un calme apparent, dont on finit par décrypter la nature.
Les mélodies et rythmes autochtones dont Mali Obomsawin fait usage sont simples et purs. L’intégration de ces matériaux traditionnels dans le jazz contemporain, une pratique musicale forcément plus complexe est une étape incontournable à l’essor des Premières Nations à travers la création musicale. La contrebassiste, chanteuse et leader peut compter sur une solide éducation musicale en jazz de chambre contemporain, comme c’est le cas de ses collègues, sans toutefois révéler un niveau exceptionnel dans l’exécution.
Néanmoins, on passe un bon moment avec Mali Obomsawin, on apprécie son jeu, son chant, son esprit, sa direction, et aussi sa reprise touchante de Buffy Sainte-Marie, Little Wheel Spin And Spin.
Et on est curieux de la suite. Le jazz autochtone ne compte pas énormément de praticiens. On connaît surtout (et pas assez) la chanteuse swing Mildred Bailey(1907-1951), issue de la nation Coeur d’Alene dans l’Idaho , authentique pionnière du chant jazz ayant été une grande influence pour les plus grandes – Ella Fitzgerald, notamment. On connaît aussi feu Jim Pepper (1941-1992), très bon saxophoniste ténor issu de la nation Muscogee Creek, collaborateur de Charlie Haden dans le Liberation Music Orchestra, musicien à qui l’on doit ausi l’hymne Wichitai To, que connaissent tous les fans de Robert Charlebois sans nécessairement en savoir les origines.
Il y a certes d’autres musiciens autochtones qui circulent sur la planète jazz, on imagine qu’il y en aura beaucoup plus dans un avenir pas si lointain.
Alain Brunet