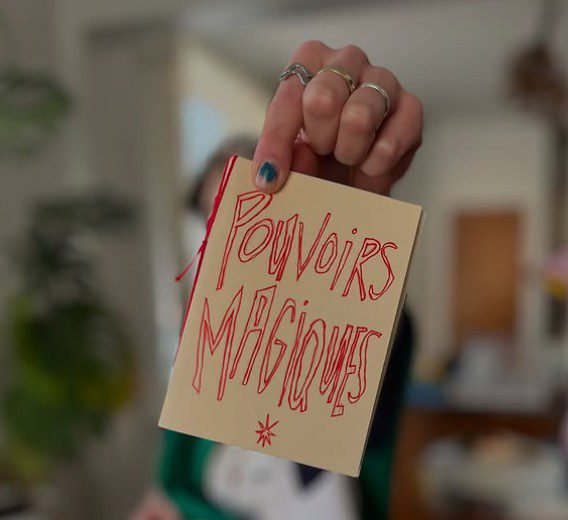Saxophoniste volcanique, chef d’orchestre, compositeur, improvisateur, interprète, Mats Gustafsson est un habitué du FIMAV et des scènes d’avant-garde du Québec. FIRE !, une de ses nombreuses formations, s’est déjà produit en trio, mais pour la première fois avec un orchestre complet. Pour pallier l’impossibilité financière de faire tourner un grand ensemble, FIRE ! Orchestra a mis au point la formule des activités communautaires (AC), en invitant des musiciens des marchés où le groupe se produit. Ainsi, 14 musiciens du Québec et du Canada se rendront à Victoriaville pour répéter en vue du concert prévu le 17 mai. Fondé en 2009 par Mats et Johan Berthling, FIRE ! s’inscrit à la fois dans free jazz, dans le groove, le psychédélisme et aussi l’esprit rock. Gros samedi en perspective!
PAN M 360 : FIRE ! The Thing, Gush, Swedish Azz, Fake (the facts), Ensemble E, Cosmic Ear et d’autres encore : y a-t-il une hiérarchie dans vos priorités artistiques parmi les groupes auxquels vous participez ?
Mats Gustafsson : Chaque projet a ses propres priorités. Mais avec Fire ! Trio et Fire ! Orchestra, nous considérons ces groupes comme des « working groups », ce qui signifie qu’ils tournent beaucoup et participent à des festivals et à des projets. Swedish Azz and Fake (Facts) est en pause. Le projet est terminé pour l’instant. L’Ensemble E essaiera de réaliser quelques festivals et projets en 2026 et 2027. Cosmic Ear et le prochain Backengrillen (avec les membres fondateurs de Refused) tourneront et travailleront en tant que groupe prioritaire en 2026/27. Je me sens privilégié de pouvoir travailler avec autant de groupes et d’artistes formidables. C’est une possibilité incroyable de pousser la musique plus loin.
PAN M 360 : Vous enregistrez beaucoup, votre page Bandcamp est assez impressionnante ! Est-ce devenu un mode de vie, ou est-ce simplement un état de votre grande énergie en tant que chef de groupe, compositeur et musicien ?
Mats Gustafsson : Mon Bandcamp est géré par Trost et Catalytic et je n’y suis pas vraiment actif. Je n’ai tout simplement pas le temps de m’en occuper. J’aime faire des disques et j’aime les collectionner. J’aime que ma musique soit disponible – donc, oui, Bandcamp est une bonne plateforme pour trouver des choses. J’essaie de ne pas sortir d’albums qui ne sont que des enregistrements publics. Je préfère travailler sur un album dans un vrai studio, avec tout ce que cela implique. En ce moment, il y a tellement de grands projets en cours. Le temps manque. Je fais de mon mieux pour rester sain d’esprit dans ce flux immense de nouveaux projets et d’idées. Il n’y a pas d’autre moyen que d’y mettre tout ce que l’on a. Tout mon dévouement, mon amour et mon énergie doivent aller dans ces projets. Je ne me retiens pas. Si l’énergie n’est pas là, je préfère rester chez moi. Il est important d’enregistrer les projets auxquels vous participez. Il est important d’enregistrer les projets dans lesquels on est impliqué, afin de faire des disques et, à partir de là, d’avoir la possibilité de travailler dans des festivals et des clubs. Pour diffuser la musique. Il ne sert à rien de laisser vos disques sur une étagère quelque part. Vous les apportez pour les vendre ou les donner en tournée. C’est notre responsabilité envers l’auditeur, en tant qu’artistes. J’aime le geste de faire des disques. Faire des albums. De vrais albums avec un ordre des pistes, une couverture, des notes de pochette, une illustration et un design. Je suis totalement allergique aux mécanismes de clics et d’algorithmes d’aujourd’hui. De vrais albums pour de vraies personnes. Les listes de lecture ne sont que des cassettes.
PAN M 360 : Au cours des dernières années, quels ont été vos projets les plus motivants ?
Mats Gustafsson : Chaque projet doit être motivé. Sinon, il vaut mieux rester chez soi. Il n’y a pas de doute. Si je ne me sens pas à 100 % dans un projet, il est mis en attente ou simplement arrêté. Je dois être totalement fidèle à la musique et aux personnes avec lesquelles je travaille. Il n’y a pas d’autre solution. Je dois trouver un équilibre entre les groupes de travail et les projets à long terme (Fire !, GUSH, AALY Trio, etc.), d’une part, et les nouveaux projets et les situations ad hoc, d’autre part. J’ai besoin des deux. L’un alimente l’autre en contenu, en énergie et en inspiration. J’ai eu beaucoup de plaisir à lancer de nouveaux projets ces dernières années. « La semaine dernière, un nouveau projet a vu le jour : La semaine dernière, un nouveau projet a vu le jour : « Action Now« , initié par le grand bassiste norvégien Nicolas Leirtrø, accompagné de Kit Downes à l’orgue et de Veslemøy Narvesen à la batterie. Hilarant. L’année prochaine verra la naissance d’un grand groupe de garage / beat / free jazz, « The Mag-Nuts », avec le grand guitariste norvégien Hedvig Mollestad : « The Mag-Nuts » avec le grand guitariste norvégien Hedvig Mollestad. De nouvelles choses vont continuer à se produire. Les idées ne manquent pas, je peux vous le dire. Il n’y a pas de repos pour les méchants. Mais c’est une période extraordinaire pour la musique créative. Il y a tellement d’excellents jeunes musiciens en ce moment.
PAN M 360 : Votre projet Cosmic Ear lance un album à la fin du mois. Pourriez-vous décrire brièvement ce projet et ses membres ? Comment s’intègre-t-il dans vos autres projets ?
Mats Gustafsson : Ça me va comme un gant ! C’est un vieux rêve de Goran et de moi-même. Créer un petit groupe où nous pourrions jouer ensemble et inclure notre héros et maestro Christer Bothén. Il a fallu quelques années pour prendre la décision…. Et pour trouver la composition parfaite. Nous l’avons maintenant. C’est génial sans batteur et avec seulement des percussions. Cela ouvre la musique et donne beaucoup d’espace aux instruments à cordes de Christer. Nous reprenons des morceaux de l’héritage de Don Cherry et de la musique folklorique du Mali, du Maroc et de la Scandinavie. Nous mélangeons le tout avec de l’électronique en direct et tout le reste. Je suis très enthousiaste à propos de ce groupe !
PAN M 360: Does FIRE! Orchestra, as a trio, tour a lot? Does it operate in creative cycles, with other projects in between?
Mats Gustafsson : Fire ! en tant que trio tourne beaucoup en ce moment. Nous avons un nouvel agent : Swamp booking. Ils sont formidables. Nous sommes plus occupés que jamais. Après une pause de presque 2 ans. La musique est en train d’arriver et nous attendons avec impatience tout ce qui va arriver. En ce moment, nous faisons quatre tournées par an, plus des projets, des résidences et des festivals. Nous n’avons jamais été aussi occupés. Nous avons tous les trois d’autres projets entre-temps, mais nous essayons vraiment de mettre l’accent sur le travail avec le trio et le Fire ! Orchestra. La nouvelle version du Fire ! Orchestra sera composée de 19 membres du groupe et la première de la nouvelle pièce « WORDS » aura lieu en novembre de cette année. Attendez-vous à plus de riffs !
PAN M 40 : FIRE ! compte 18 enregistrements – c’est beaucoup ! Avez-vous des favoris ?
Mats Gustafsson : 18 enregistrements ? Avec le trio, l’orchestre et des projets spéciaux ? C’est impressionnant. C’est beaucoup. Ha ha. Mais nous sommes actifs depuis longtemps. Nous avons commencé en 2009. L’idée est de sortir un album studio tous les 2 ou 3 ans, tant avec le trio qu’avec l’orchestre. Nous pensons que c’est un bon plan. Le prochain est toujours mon préféré. Je ne peux en citer aucun. Je dois dire que je suis très heureux et fier de tout ce que nous avons fait. Diriger un orchestre à cette époque…. Et partir en tournée avec, c’est impossible. Mais nous voulons montrer que l’impossible est encore possible. Nous voulons payer nos membres décemment, c’est pourquoi nous refusons beaucoup d’offres.
Mais d’une manière ou d’une autre, cela fonctionne… et nous sommes toujours debout. C’est vraiment extraordinaire de travailler avec un grand ensemble et nous sommes très heureux de la nouvelle idée des CBA (activités communautaires) où nous travaillons avec des musiciens locaux. Comme à Victoriaville. Tout le monde y gagne. Nous élargissons nos cercles/réseaux – de nouvelles personnes rejoignent la famille Fire ! Orchestra. Et la scène locale se connecte à notre musique. Et en théorie, cela devrait coûter moins cher au diffuseur local. Nous réalisons donc les projets de l’ABC 4 à 5 fois par an et l’activité régulière avec Fire ! Orchestra. Nous venons de terminer la version ECHOES par un concert à Gdansk en Pologne. Et nous avons hâte de jouer des parties d’ECHOES (et quelques nouveaux morceaux) au Canada.Mais d’une manière ou d’une autre, cela fonctionne… et nous sommes toujours debout. C’est vraiment extraordinaire de travailler avec un grand ensemble et nous sommes très heureux de la nouvelle idée des CBA (activités communautaires) où nous travaillons avec des musiciens locaux. Comme à Victoriaville. Tout le monde y gagne. Nous élargissons nos cercles/réseaux – de nouvelles personnes rejoignent la famille Fire ! Orchestra. Et la scène locale se connecte à notre musique. Et en théorie, cela devrait coûter moins cher au diffuseur local. Nous réalisons donc les projets de l’ABC 4 à 5 fois par an et l’activité régulière avec Fire ! Orchestra. Nous venons de terminer la version ECHOES par un concert à Gdansk en Pologne. Et nous avons hâte de jouer des parties d’ECHOES (et quelques nouveaux morceaux) au Canada.
PAN M 360 : Quels ont été les derniers développements dans l’ensemble ?
Mats Gustafsson : Eh bien, l’ajout de nouveaux noms est ce qui l’affecte le plus. Nous écrivons très spécifiquement pour les membres du groupe, comme l’ont fait Duke Ellington et Sun Ra. Nous utilisons les voix individuelles du groupe dans un cadre collectif. Nous avons donc réussi à intégrer dans le groupe quelques personnes ayant participé à des projets CBA antérieurs. C’est ainsi que les choses fonctionnent et devraient fonctionner. L’intégration d’Anna Neubert au violon et d’Emily Wittbrodt au violoncelle nous donne un trio à cordes très cool avec notre propre Anna Lindal au violon. Et la présence de Maria Portugal à la batterie et au chant est tout simplement géniale. Spectaculaire ! La jeune et fantastique Adia Vanheerentals au saxophone ténor et soprano. La spectaculaire Mariam Rezaei aux platines et à l’électronique et, bien sûr, la Canadienne Lina Allemano à la trompette. Nous serons 19 personnes dans ce nouveau line-up. Un mélange de nouveaux noms et d’autres provenant de notre ancien pool d’artistes liés à Fire ! Orchestra. Il y aura des riffs. Il y aura du feu !
PAN M 360 : Comment pouvez-vous décrire brièvement l’évolution formelle du trio ? Quelle est la base de notre travail aujourd’hui ?
Mats Gustafsson : Tout simplement dépouiller. Lorsque nous avons enregistré notre dernier album « Testament » avec Steve Albini à Chicago, nous avons décidé de réduire un peu les instruments et tout le reste. Nous nous concentrons maintenant sur ce que nous pouvons faire avec seulement un sax baryton, une basse électrique et une batterie. Pas d’électronique, pas de claviers, pas d’instruments supplémentaires (enfin, un peu de flûte ne peut pas faire de tort….). Il s’agit d’une musique ouverte aux possibilités infinies. Nous n’avons aucune idée de ce que l’avenir nous réserve. Mais en 2025, c’est à cela que nous travaillons. Au début, il y avait une quantité massive d’instruments supplémentaires et beaucoup de bruit, d’électronique et tout le reste. J’adore ça aussi. Mais pour l’instant, c’est ce que fait Fire !
PAN M 360 : Parlez-nous des atouts spécifiques des membres de votre trio.
Mats Gustafsson : Ils sont tout simplement les MEILLEURS ! En tant que personnes. En tant que musiciens. Compétents, ouverts et plein d’énergie ! Andreas et Johan ont le pouvoir magique de se caler sur le groove de l’autre. C’est comme de la télépathie. Et c’était la même chose depuis le premier jour. Nous nous amusons ensemble. Et nous nous respectons à 100 %. Tout est question de confiance et de respect.
PAN M 360 : Pourquoi avoir proposé cet ensemble spécifique pour vos dates au Québec ?
Mats Gustafsson : Nous voulions vraiment jouer avec Fire ! Orchestra en Amérique du Nord, mais il était impossible de prendre l’avion avec 19 personnes. Et impossible de jouer aux États-Unis pour le moment. Il faudrait que je vende ma collection de disques pour faire venir 19 personnes. Et je ne suis pas encore prêt à m’en séparer. Nous avons donc décidé d’opter pour une version CBA après en avoir discuté avec Scott.
Nous avons eu une discussion très créative avec Scott à propos de l’alignement. Nous avons dû nous en tenir aux 5 membres originaux de Fire ! Orchestra pour des raisons budgétaires. Dans nos projets CBA, nous voyageons généralement avec 5 à 7 personnes et le reste est local. C’était une affaire créative et assez facile. Je connais beaucoup de noms et j’ai déjà joué avec certains d’entre eux. De tous les CBA que nous avons organisés, celui-ci est peut-être le plus excitant. Je ne vous le fais pas dire ! L’alignement a l’air incroyable. Une vraie tuerie. Scott et son équipe ont fait un excellent travail de repérage. Il est lui-même musicien, ce qui nous a facilité la tâche.
PAN M 360 : Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez procédé pour l’élargissement de l’offre ?
Le trio Fire ! était en tournée en Europe en 2011, et après le dernier concert de la tournée, nous nous sommes réunis. Nous avons décidé à 3 heures du matin de réunir tous nos amis musiciens à Stockholm et de jouer de la musique en TRIO. C’est fait. Nous nous sommes rencontrés et avons joué « Exit » à Fylkingen à Stockholm en 2012. 28 musiciens jouant à fond, le sourire aux lèvres. Nous devions continuer. Il n’y a pas de doute. Nous avons fait beaucoup de nouveaux morceaux par la suite, tous avec des effectifs différents. Y compris une réécriture des « Actions for free jazz » de Penderecki, avec la bénédiction des compositeurs. Fire! Orchestra est très vivant et en constante évolution. C’est une nécessité.
PAN M 360 : Comment distribuez-vous les instructions aux musiciens ?
Mats Gustafsson : Il y a un fichier Google Drive – avec des partitions, des fichiers musicaux, des liens, des vidéos, etc. Nous avons un plan approximatif de ce que nous allons jouer. La plupart des morceaux sont tirés de notre dernière version Echoes, mais nous pourrions aussi jouer quelques nouveaux morceaux. Plus quelques formations ouvertes. Des formations ad hoc et des solos. Tout dépend du déroulement des répétitions. Nous pouvons changer beaucoup de choses jusqu’au concert. Certains musiciens nous ont envoyé des courriels pour nous demander des choses spécifiques et nous essayons de répondre à toutes les questions. Tout sera clair lorsque nous nous rencontrerons et répéterons ensemble. C’est la clé de ces quelques jours de travail en commun. Apprendre à se connaître et se familiariser avec le son d’ensemble de cette version. Nous sommes impatients.
PAN M 360 : Comment trouvez-vous l’équlibre entre la composition et l’improvisation dans le contexte d’un grand groupe ? Y a-t-il des parties écrites ?
Mats Gustafsson : Attendez /voyez / écoutez ! Oui, il y a un mélange d’arrangements écrits et de matériaux et mélodies composés. Les riffs de base sont le fondement de toute notre musique. C’est donc un riff que vous entendrez ! Arrangements de cor par Mats Äleklint qui nous rejoint pour ce voyage. Le trombone des durs à cuire. Le plus bruyant et le meilleur qui soit. Je fais aussi beaucoup de conduites, contrôlant et bousculant les formes et les structures. Les conduites peuvent apparaître et apparaîtront à n’importe quel moment de la pièce. Elles indiquent certains arrangements, solos et compositions instantanées. Tout sera différent. Les répétitions seront une chose – et le concert pourrait être quelque chose de complètement différent. Voyons ce qu’il en est. Nous avons 5 à 6 pièces à faire, toutes avec des arrangements et une idée de forme de base. Il y aura beaucoup d’espace pour des ponts ouverts entre ces morceaux. Il y aura aussi des introductions et des extros qui changeront d’un jour à l’autre. Johan et moi communiquons pendant le morceau et serons capables de changer les choses en une fraction de seconde, lorsque cela sera nécessaire.
PAN M 360 : Comment voyez-vous le fait de diriger un si grand ensemble ? Quels sont les défis à relever ?
Mats Gustafsson : Tant que les gens sont attentifs, il n’y a pas de véritables problèmes. Il n’y a que de la joie ! Je travaille avec des signes et des conduites assez simples et, en général, ils ne sont pas vraiment difficiles à suivre. Il n’y a rien de sorcier là-dedans. J’adore diriger – et c’est un tel privilège de le faire avec de grands musiciens. Et cette sélection est spectaculaire ! La joie à l’état pur !
BILLETS + INFOS