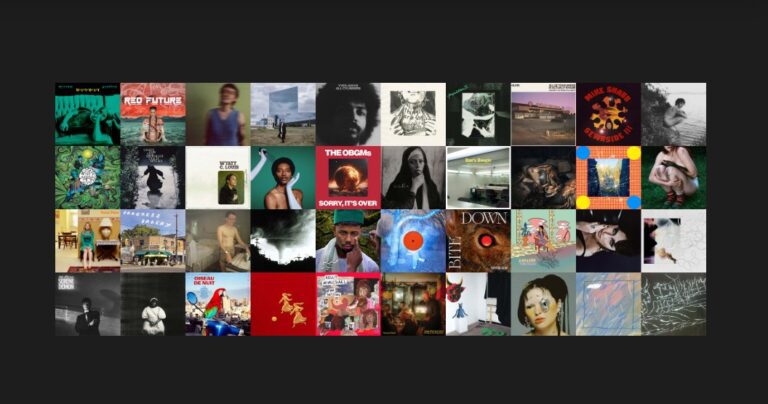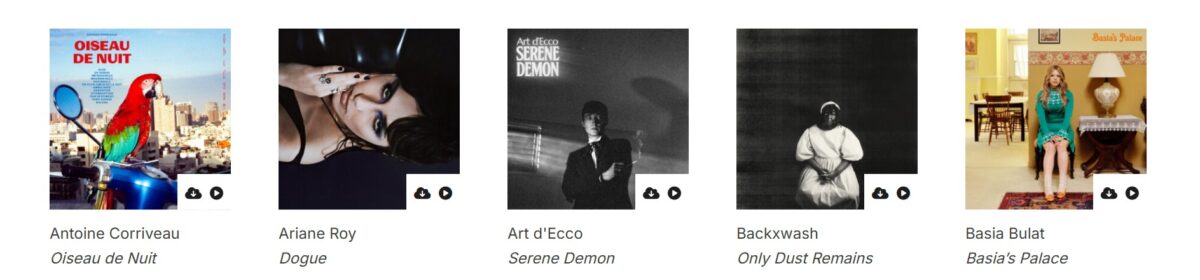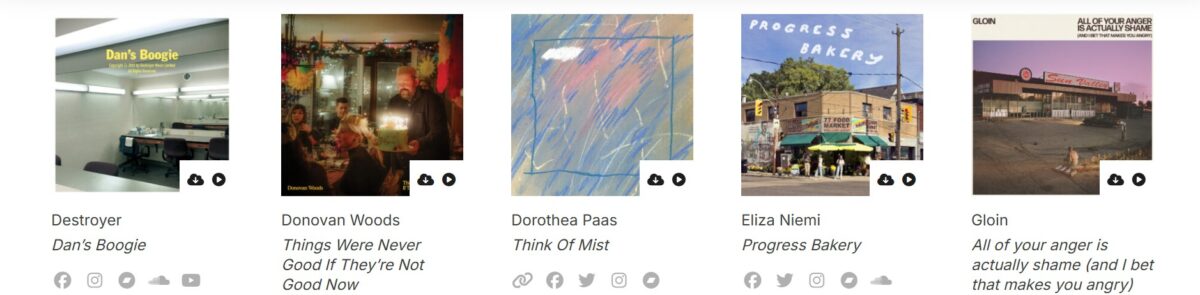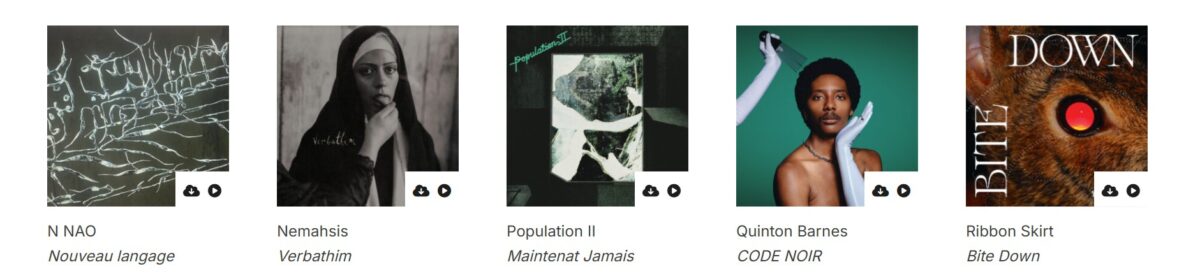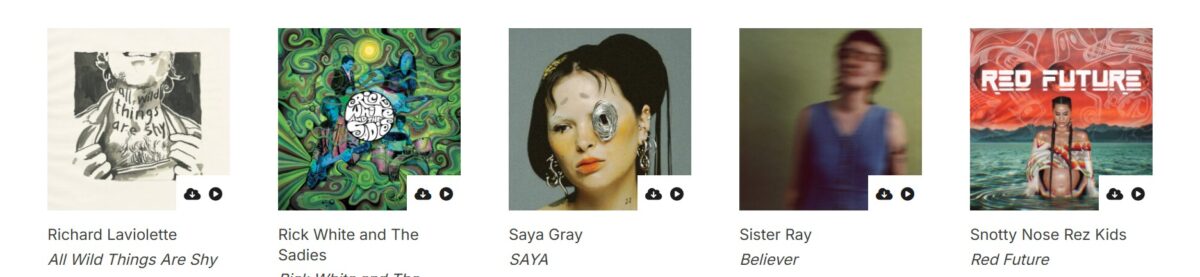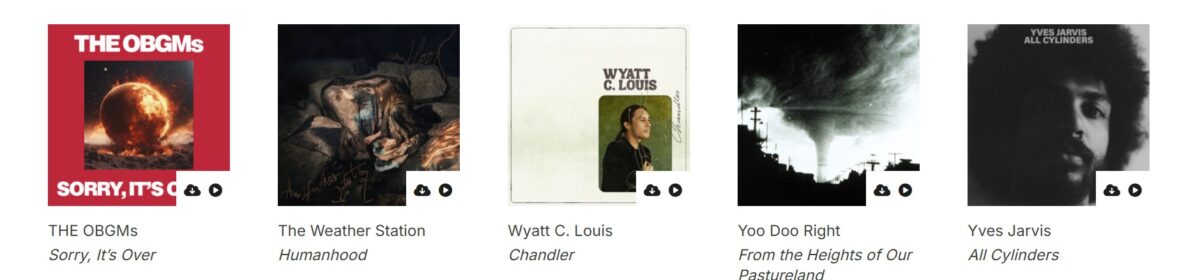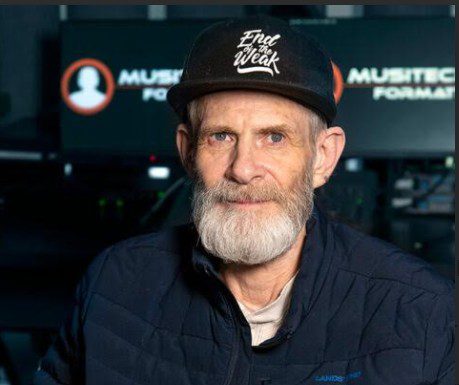Ceci n’est pas une critique. C’est plutôt un commentaire sur une critique parue dans Le Devoir, le jeudi 23 janvier. Pourquoi? Pas pour revenir sur les appréciations esthétiques, ou non, de mon éminent collègue (Christophe Huss, pour le nommer), mais plutôt sur le message sous-jacent qui accompagnait ce texte.
M. Huss a commenté le concert L’inoubliable Concerto pour violon de Bruch de l’OSM, mettant en vedette le violoniste afro américain Randall Goosby, la cheffe ukrainienne Dalia Stasevska, puis la musique de Bruch, de Dvořák, de Florence Price et de l’Islandaise contemporaine Anna Thorvaldsdottir. Le critique n’a pas aimé la partition Archora de Thorvaldsdottir. Soit. Il n’a pas eu non plus de bons mots pour la prestation du jeune violoniste Goosby. Fort bien. Cela lui appartient, en tant que critique, et M. Huss explique largement les raisons musicales et analytiques de son diagnostic subjectif. Mon objectif ici n’est pas de remettre en question ses opinions en la matière. Je suis en désaccord avec certains de ses constats, en accord avec d’autres.
En toute transparence, je dirai ceci : j’aime la musique de Thorvaldsdottir. Bien que Archora pêche par un certaine longueur, j’y ai entendu un très beau discours narratif, appuyé sur de longues vagues soutenues aux cordes et aux cuivres sur lesquelles frémissent ou apparaissent spontanément des sonorités texturales intéressantes, dans un canevas général expressif et dramatique qui plonge l’auditeur dans une sorte de sombre et profonde abysse océanique. On s’y imagine, flottant dans des remous enveloppants et régulièrement mordillés par quelque créature invisible. La remontée finale vers une lumière discrète mais bienfaisante rassure et apaise convenablement. Une belle musique contemporaine dans le style actuel, à mi-chemin entre la musique savante académique et la musique cinématographique.
En toute transparence également, la prestation de M. Goosby m’a semblé appréciable. Pas la lecture la plus lumineuse du Concerto pour violon no 1 en sol mineur, op. 26 de Bruch, j’en conviens, mais à travers une interprétation sobre, voire prudente, j’ai eu du plaisir à remarquer plusieurs beaux élans expressifs ainsi qu’une technique fine et précise. Bien sûr, je reconnais aussi que j’ai entendu M. Goosby le jeudi soir, et M. Huss l’a entendu le mercredi. Des améliorations ont peut-être eu lieu en 24 heures.
Mais tout cela est accessoire. M. Huss a ses sensibilités, j’ai les miennes, ce qui est normal et même nécessaire. Le problème du texte de mon collègue est ailleurs.
Amalgames boiteux, sous-entendus douteux
Ce qui m’a semblé critiquable, voire détestable, dans l’article de M. Huss, ce sont les amalgames que je qualifierais d’opportunistes qu’il s’est permis de faire avec le sujet de la ‘’diversité’’ dans les programmations symphoniques. Je ne réécrirai pas ses paragraphes, mais l’essentiel du sous-entendu (en fait, pas vraiment ‘’sous’’) est que la femme Thorvaldsdottir et le Noir Goosby étaient présents parce que l’OSM est tombé dans ‘’l’idéologie’’ de la diversité plutôt que de rester fidèle à la pureté artistique. De plus, l’OM voisin en paie le prix aujourd’hui (référence aux annulations de concerts annoncées récemment) si bien que l’OSM devrait prendre note.
Permettez-moi d’apporter quelques bémols à cette partition assez usée merci.
Il est dit dans le texte que Randall Goosby ‘’a déboulé subitement, en octobre 2020, à 24 ans, comme nouveau violoniste Decca alors qu’il avait totalement échappé aux radars précédemment’’. Sans être le Reine-Élizabeth en termes de reconnaissance, loin s’en faut, disons quand même que le jeune homme jouait avec un orchestre symphonique à l’âge de neuf ans (Jacksonville) et 13 ans (New York Phil, un concert Young People) et qu’il a reçu un Avery Fisher Grant en 2022 (après son contrat Decca, je reconnais). Quand on recherche un peu d’autres commentaires sur ses concerts, ailleurs sur le web, on trouve des critiques très positives et des rapports de publics très heureux et impressionnés. Ça vaut ce que ça vaut, bien sûr, mais je ne vois pas non plus d’imposture flagrante.
M. Huss ajoute : ‘’Nous n’avions pas perçu des disques Decca que Goosby était un prodige ou un génie du violon. Les disques ne nous trompaient pas’’. Peut-être parce que le répertoire choisi par l’artiste (et la maison de disque) faisait place à des musiques marginales, que l’artiste joue d’ailleurs plutôt bien? Son premier album, Roots, se consacrait à des pièces de compositeurs.trices afro américains, donc bien moins connues et propices aux comparaisons pointues des prêtres/gardiens du Temple du répertoire classique. Son deuxième se concentrait sur la musique de Joseph Boulogne, compositeur noir et individu de talent exceptionnel, presque exactement contemporain de Mozart. Encore là, du répertoire probablement encore ‘’insignifiant’’ pour quelques observateurs, mais néanmoins de belle facture, en tous cas pas moindre que pour de nombreux autres Vanhal, Cannabich ou Reinecke bien blancs et européens.
Randall Goosby a entièrement raison de parcourir ces pans de la musique savante occidentale, car elle demeure négligée pour des raisons d’exclusivisme et de mépris hautain longtemps généralisé. Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler demeurent en haut de la pile, mais l’élargissement de la perspective fait du bien et stimule nos émotions esthétiques avec des musiques qui ont des racines profondes et une signification puissante, en plus d’être tout simplement bonnes.
Pendant presque deux siècles, on ne jouait plus aucun Baroque. Il a fallu insister pour qu’on redécouvre des perles, mais aussi du matériel ‘’moyen’’ qui demeure tout de même extrêmement agréable à écouter, encore et encore.
Bref, rien dans ce que je viens de dire ne fait de Randall Goosby un génie musical que mon collègue n’a pas reconnu, mais rien non plus, rien du tout, ne permet de penser que seule sa couleur de peau lui a mérité un contrat de disque et des engagements professionnels.
Qui fait de l’idéologie, vraiment?
Des interprètes ‘’ordinaires’’, il y en a eu des tas, engagés par tous les orchestres au fil des décennies. Pendant longtemps ils étaient tous Blancs occidentaux, ou presque. C’est donc dire que, soit leur couleur de peau comptait et le retour de balancier actuel n’est qu’un rééquilibrage normal (en confirmant du même souffle l’existence longtemps dénoncée du ‘’privilège blanc’’ et du ‘’racisme systémique’’), soit non et alors l’engagement d’interprètes d’ordre inférieur n’a jamais été une question ‘’d’idéologie’’, mais une pratique inévitable dans la perspective d’une quantité phénoménale de concerts à donner partout dans le monde.
Au final, les suggestions de M. Huss quant à une sorte de dérive idéologique pour expliquer la présence d’un interprète comme Randall Goosby sont malvenues, voire grandement exagérées, et surtout non appuyées par des preuves tangibles.
Je pourrais utiliser les mêmes structures argumentaires pour arriver au même constat en ce qui concerne la présence d’une partition de Mme Thorvaldsdottir. Et aussi relever l’ironie que M. Huss a apprécié la cheffe, Dalia Stasevska, une femme. S’il y a avait idéologie derrière ce concert, il devra reconnaître qu’elle a visé juste dans ce cas. Mmmmm…
Mais je mettrai fin ici à cette partie pour relever un deuxième point de l’article du Devoir : l’explication des déboires de l’Orchestre Métropolitain par, encore, ‘’l’idéologie’’ diversité.
M. Huss saisit la balle au bond, tel un virtuose de l’arrêt-court au baseball, époque Ozzie Smith. L’annulation de deux concerts de l’OM, pour lui, est comme un cadeau de ‘’Rudolph le renne au nez rouge’’, ce qui montre bien le biais opportuniste, mais pas tant réfléchi, de l’argument.
L’Orchestre dirigé par Yannick Nézet-Séguin a annoncé l’annulation des concerts Amour fatal et Fiesta latina il y a quelques jours. Dans le premier, la musique de Saint-Saëns, Bizet, Strauss… et un seul titre, assez court, de la Française romantique Mel Bonis. Dans le deuxième, de la musique, en effet, latine. Gershwin, Bernstein (West Side Story) et la pianiste Gabriela Montero, assez populaire en général. La ‘’diversité’’ de ces concerts explique-t-elle leur annulation? Manque de billets vendus, ou alors difficultés économiques plus vastes (que M. Huss mentionne, à sa décharge) qui imposent ces coupures sans pour autant inclure obligatoirement la faute à la ‘’diversité’’? À mon avis, le flou est bien trop vaste pour sauter à des conclusions qui dénoncent l’emprise d’une ‘’idéologie’’, mais qui le font d’une manière on ne peut plus… ‘’idéologique’’!
Ajoutons aussi que, dans les concerts qui n’ont pas été annulés : des œuvres de Julia Adolphe (inconnue de ma part), d’Emilie Mayer et de Barbara Assiginaak. Il est vrai que celles-ci sont entourées de piliers du répertoire signés Mozart, Schubert et Tchaïkovski. Mais est-ce suffisant pour prouver un point?
M. Huss précise qu’il s’agit peut-être d’un ‘’retour d’ascenseur’’. Le public bouderait l’OM pour ses choix de ‘’diversité ostentatoire’’ dans les dernières saisons. Ouais, bon. Peut-être?
Mais à Pan M 360 nous avons constaté que la problématique s’explique possiblement par d’autres raisons. Par exemple : les productions du groupe GFN, incluant l’Orchestre FILMharmonique (les ultra populaires ciné-concerts), le Chœur des Mélomanes et d’autres offres très variées, éclectiques, ou encore celles de la série Candlelight, non seulement remportent un grand succès populaire mais semblent convaincre une partie du nouveau public gagné difficilement par l’OM (et l’OSM) à migrer chez eux. Ce public est aussi plus ‘’diversifié’’. Pourquoi se déplace-t-il ailleurs? Il faudrait analyser cela en profondeur. Mais nous doutons qu’un retour strict à une programmation basée essentiellement sur les mêmes 30 ou 40 chefs-d’œuvre absolus, que nous aimons profondément mais qui roulent en boucle dans des cycles de 5 à 10 ans, les feront revenir.
Un public diversifié et apparemment fidèle se présente aussi, selon nos observations, aux événements de l’ensemble Obiora, constitué, justement, de musiciens et musiciennes de la ‘’diversité’’. Alors, y -t-il réellement un problème avec les programmes non conventionnels? Manifestement pas pour tout le monde.
Les problèmes financiers de l’OM peuvent aussi s’expliquer par des choix d’investissements ciblés, qui se défendent, mais qui ne sont pas liés à la diversité et qui peuvent constituer un poids important sur les finances de l’organisation. La tournée européenne à venir coûtera cher. Certaines soirées bénéfices, grandioses et probablement coûteuses, réduisent la marge de revenus qui en découlent. Etc. Mon objectif n’est pas de dire à l’OM comment conduire ses affaires, mais plutôt de démontrer que le problème peut difficilement être attribué uniquement à la programmation des dernières années et la présence dans celle-ci de femmes, de Noirs, d’Autochtones ou quiconque n’a pas l’allure de Bruckner, Schubert ou le pianiste Wilhelm Kempff. M. Huss n’a manifestement pas pris le temps de bien creuser la question.
Loin d’être une mode, la diversité est un mouvement irréversible
À PAN M 360, nous sommes conscients que le monde de la musique classique fait actuellement des efforts pour inclure plus de ‘’diversité’’ dans ses programmes (compositeurs, compositrices, interprètes, styles musicaux visités par de nouvelles œuvres, etc.). Ces efforts visent à explorer une plus large part de l’expérience humaine, artistique et intellectuelle que constitue la création musicale savante. Une part qui rend plus fidèlement compte de la vastitude de ses déclinaisons individuelles. Parfois, les résultats ne sont pas convaincants. Parfois, tout à fait. Le dosage sera peut-être à revoir, nous ne nions pas les nécessités d’ajustement dans l’exercice de programmation. Mais nous ne cautionnons pas des déductions simplistes qui concluent à une équation automatique associant ‘’qualité inférieure’’ avec genre ou origine ethnoculturelle en musique classique. Nous avons entendus assez de concerts pour savoir que la médiocrité est de toutes les couleurs et provenances, et ce depuis bien plus longtemps que l’avènement d’une soi-disant ‘’idéologie’’ sur la diversité.
Nous ne voyons pas non plus en quoi la diversité comme principe expliquerait les déboires financiers de certaines institutions. Nous constatons plutôt un besoin qui grandit et un public potentiel ‘’à travailler’’ de façon plus efficace et convaincante. Un besoin qui ne disparaîtra pas puisque la démographie traditionnelle de l’Occident est en train de se métamorphoser à vitesse grand V, en termes ethnoculturels. Quant à la moitié de la population traditionnelle de l’Occident, les femmes, elle ne reviendra pas de sitôt à un anonymat contemplatif placé dans l’ombre de l’autre demie. Aucun chef-d’œuvre traditionnel n’est menacé. Il y a suffisamment d’espace pour tous et toutes.
La diversité est une réalité. Nous devons le reconnaître et embrasser ses possibilités. Quelles méthodes utiliser pour jouer en harmonie avec elle, sans négliger les sommets historiques de l’expression humaine? Qu’en fait-on, comment, pourquoi, pour qui? Le débat est ouvert, et doit l’être. Mais son principe même ne peut tout simplement être remis en question, encore moins être qualifié de ‘’mode’’. Tout le monde doit être convié à la discussion. Celle-ci ne doit pas être laissée entre les mains de quelques personnes qui semblent, à priori, en avoir déjà estimé la conclusion de façon méprisante et condescendante.
En faisant les sous-entendus qu’il a fait de façon précipitée et opportuniste, dans un argumentaire bien écrit mais intellectuellement fragile, voire maladroit, mon collègue dont j’estime quand même la science et le savoir, a ouvert la porte non pas à ce débat essentiel et constructif, mais à l’arrivée dans celui-ci de ceux qui envahissent également les réseaux sociaux pour y implanter de façon agressive et violente leur propre… idéologie d’arrière-garde.
Ce faisant, M. Huss a malheureusement confirmé un autre cliché désolant dans la tête de certains irascibles ‘’wokes’’ : celui du méchant Homme blanc d’un âge moyen, incapable de concevoir le monde en dehors de ses propres privilèges acquis et dégustés sans retenue au cours des derniers siècles.
Source de l’article cité :
https://www.ledevoir.com/culture/musique/835483/critique-concert-fantasia-declin-empire-symphonique